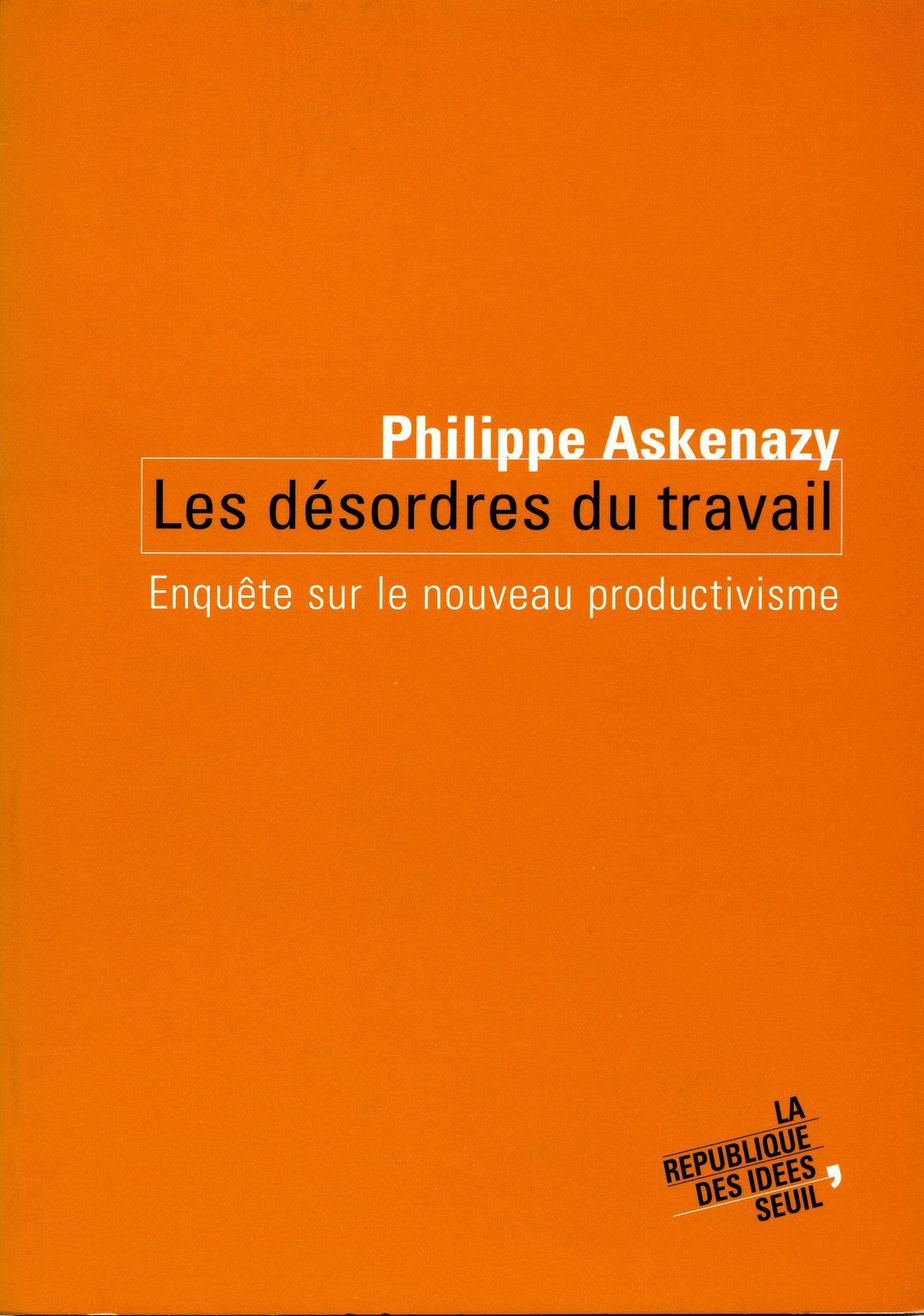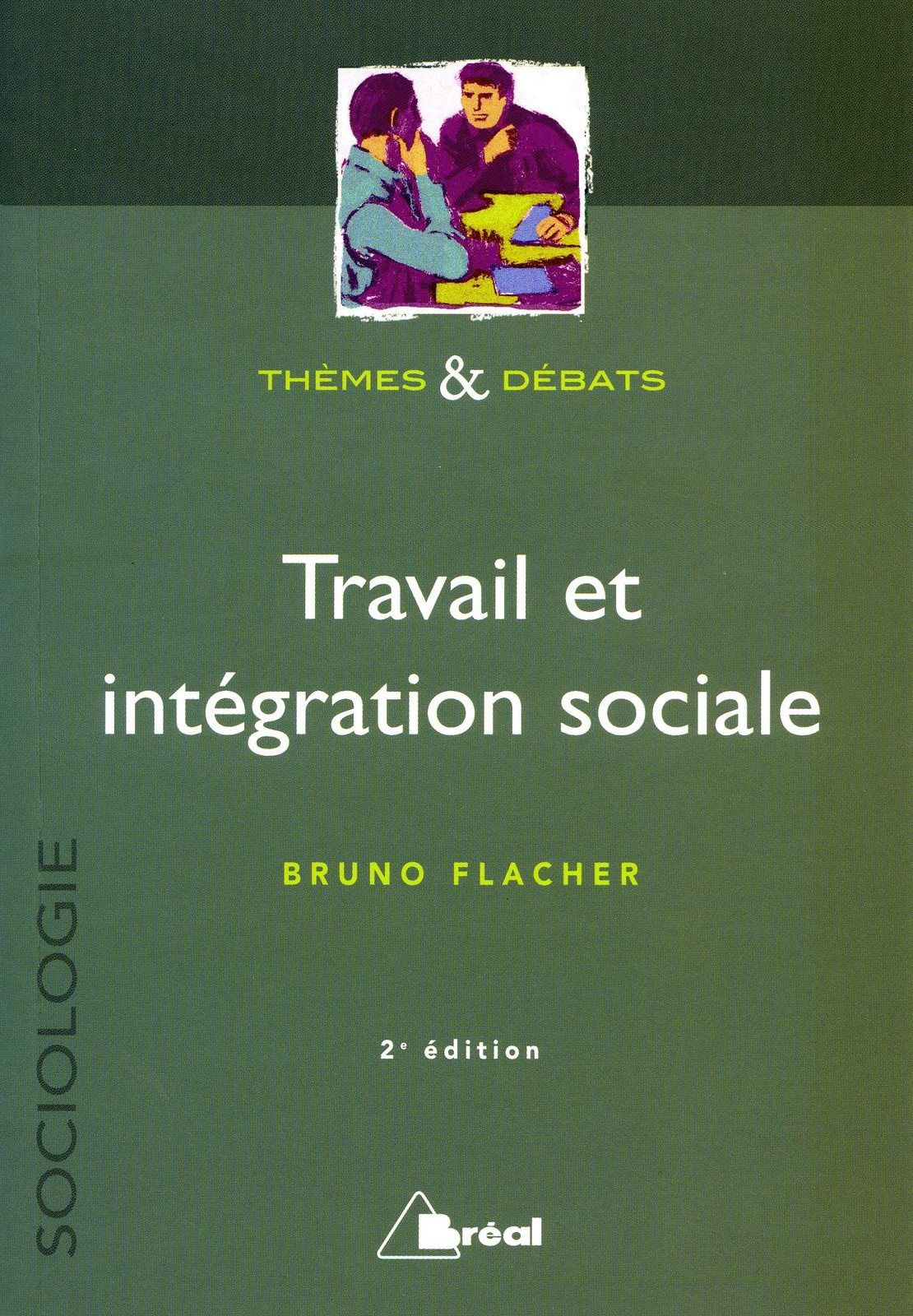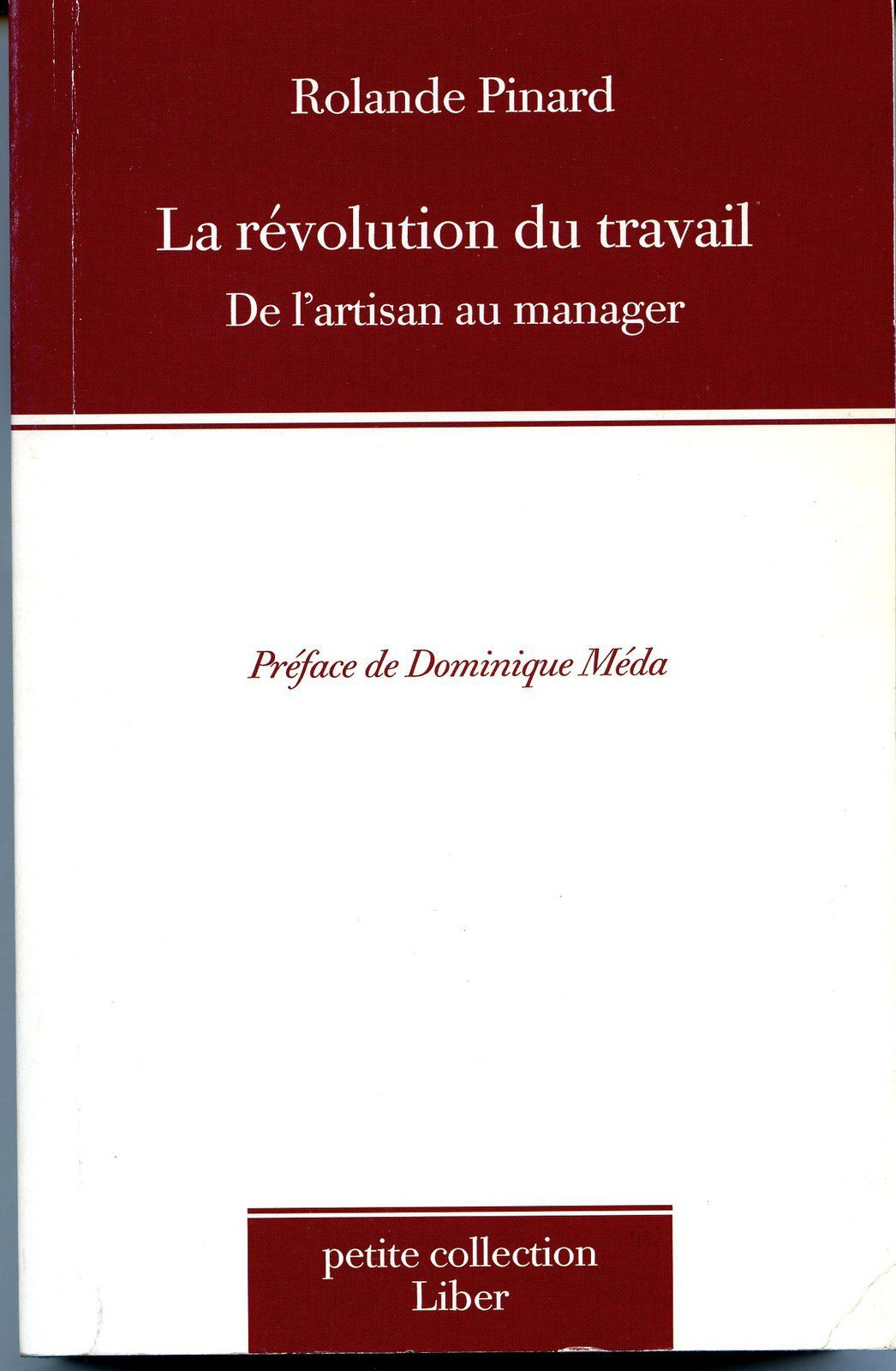Que devient le travail ? (La condition humaine à l'époque numérique 6 et 7/7)
Cours donné à l'Université du Temps Libre d'Orléans les 9 mars et 6 avril 2017.
Le travail, à travers différents termes (valeur travail, emploi, chômage et aujourd’hui revenu universel) se trouve au cœur de chaque campagne présidentielle mais toujours de la façon la plus confuse.
On veut du débat, par-dessus tout du débat. Plus notre monde est rigide, incapable de changer ne fût-ce qu'un peu, plus il nous faut du débat Mais rien ne menace plus le débat que cet impératif à débattre. On se précipite pour mettre en scène une contradiction, entendre les pour et les contre. On néglige un point : pour et contre quoi ? Le « débat » se déploie et on ne sait même pas de quoi on parle. Les problèmes sont vagues, mal posés, ou plutôt posés en fonction des prises de position que l'on veut manifester bruyamment. On oublie un effort de la pensée autrement plus noble et plus impérieux : atteindre plus de précision quant à ce sur quoi il y a lieu, justement, de se prononcer. Bergson disait : « Un problème bien posé est déjà à moitié résolu. » On pourrait dire : un événement bien défini ne laisse déjà presque plus de place au débat. Non pas qu'il n 'existe alors qu'une seule voie vers lui et à partir de lui, mais la diversité des manières de penser ne peut plus alors se résoudre à du «pour ou contre »; elle devient une question d'inventions et de nuances. [1]
En introduction à la question « Que devient le travail ? », je vous propose, préparatoire à mon premier livre[2] consacré à Arendt, le texte suivant.
La réflexion sur le travail traverse l’ensemble de Condition de l’homme moderne. Si Hannah Arendt lui consacre un chapitre central elle en fait un élément fort dès son prologue.
Elle pointe l’aspect paradoxal de cet évènement. Un souhait vieux comme l’histoire se réalise dans une époque qui s’accompagne de la glorification théorique du travail et a transformé la société toute entière en une société de travailleurs.
C'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. (...) Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire.
Le travail occupe une place centrale entre les deux chapitres qui regroupent, distinguent et positionnent les trois modalités de l’activité humaine et ceux consacrés à l’œuvre et à l’action. Il est aussi à la conclusion même du livre dans un dernier chapitre qui se conclut par « le triomphe de l’animal laborans », autrement dit le triomphe de l’homme comme « animal travaillant ». La structure même de Condition de l’homme moderne reflète la position centrale du travail dans nos sociétés.
Hannah Arendt débute sa réflexion sur la condition humaine par une proposition et trois distinctions.
Je propose le terme de vita activa pour désigner trois activités humaines fondamentales : le travail, l'œuvre et l'action. Elles sont fondamentales parce que chacune d'elles correspond aux conditions de base dans lesquelles la vie sur terre est donnée à l'homme.
Le travail est l'activité qui correspond au processus biologique du corps humain, dont la croissance spontanée, le métabolisme et éventuellement la corruption, sont liés aux productions élémentaires dont le travail nourrit ce processus vital. La condition humaine du travail est la vie elle-même.
L'œuvre est l'activité qui correspond à la non-naturalité de l'existence humaine, qui n'est pas incrustée dans l'espace et dont la mortalité n'est pas compensée par l'éternel retour cyclique de l'espèce. L'œuvre fournit un monde « artificiel » d'objets, nettement différent de tout milieu naturel. C'est à l'intérieur de ses frontières que se loge chacune des vies individuelles, alors que ce monde lui-même est destiné à leur survivre et à les transcender toutes. La condition humaine de l'œuvre est l'appartenance-au-monde.
L'action, la seule activité qui mette directement en rapport les hommes, sans l'intermédiaire des objets ni de matière, correspond à la condition humaine de la pluralité, au fait que ce sont des hommes et non pas l’homme, qui vivent sur terre et habitent le monde. (...) La pluralité est la condition de l'action humaine, parce que nous sommes tous pareils, c'est- à-dire humains, sans que jamais personne soit identique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à naître.
Ces distinctions constituent trois angles de vue, plutôt que trois définitions, utilisées pour analyser l’évolution de l’activité humaine : celui du travail et de la nécessité ; celui de l’œuvre et du monde ; celui de l’action et de la pluralité
À travers le travail, c’est donc l’activité humaine qui assure la survie de l’individu et de l’espèce que suit Hannah Arendt. Mais avant d’en analyser l’évolution, elle croise sa première distinction (travail/œuvre/action) avec une seconde : celle entre les domaines public, privé et social. Elle nous fait redécouvrir la différence capitale, chez les Anciens entre domaine public et domaine privé, différence que nous avons beaucoup de mal à percevoir depuis l’avènement de la société. Le trait distinctif du domaine familial était que les humains y vivaient ensemble à cause des nécessités et des besoins qui les y poussaient. Ils obéissaient ainsi à une force qui était la vie elle-même. Le domaine public, celui de la politique, au contraire, était celui de la liberté. La famille devait assumer les nécessités de la vie comme condition de la liberté. Cette liberté était limitée aux seuls chefs de famille libérés de la nécessité par les femmes et les esclaves enfermés, eux, dans le domaine privé.
L'apparition de la société — l'avènement du ménage, de ses activités, de ses problèmes, de ses procédés d'organisation — sortant de la pénombre du foyer pour s'installer au grand jour du domaine public, n'a pas seulement effacé l'antique frontière entre le politique et le privé. Elle a si bien changé le sens des termes, leur signification pour la vie de l'individu et du citoyen, qu'on ne les reconnaît presque plus. Depuis, la tendance à dévorer les anciennes sphères du politique et du privé, comme la plus récente, celle de l’intimité, a été l’une des caractéristiques de ce nouveau domaine, le domaine social. Cette croissance irrésistible, observée depuis trois siècles, tire son énergie du fait que, par la société, c’est le processus vital lui-même qui, sous une forme ou une autre, a pénétré le domaine public. En un temps relativement court la domination sociale a transformé toutes les collectivités modernes en sociétés de travailleurs et d’employés, dont tous les membres considèrent leur activité, quelle qu’elle soit, comme essentiellement un moyen de gagner leur vie et celle de leur famille.
Pour Arendt, la société est la forme sous laquelle on permet aux activités qui concernent la survie pure et simple, et donc au travail, de paraître en public.
Après avoir rappelé la différence entre public et privé chez les anciens, décrit l’avènement de la société et l’élévation du travail au rang d’activité publique, Arendt approfondit ce que signifie le mot « public », introduisant un concept essentiel pour la suite, celui de monde commun. Le mot « public » désigne deux phénomènes liés l'un à l'autre mais différents. II signifie d'abord que tout ce qui paraît en public peut être vu et entendu de tous, jouit de la plus grande publicité possible. Pour nous l'apparence — ce qui est vu et entendu par autrui comme par nous-mêmes — constitue la réalité. En second lieu, le mot « public » désigne le monde lui-même en ce qu'il nous est commun à tous et se distingue de la place que nous y possédons individuellement. Ce monde n'est pas identique à la Terre ou à la nature, en tant que cadre du mouvement des hommes et condition générale de la vie. Il est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de main d'homme, ainsi qu'aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par l'homme. Le monde commun nous rassemble mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les autres. Il est ce qui nous accueille à notre naissance, ce que nous laissons derrière nous en mourant. Il transcende notre vie aussi bien dans le passé que dans l'avenir; il était là avant nous, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous.
Avant d’aborder le thème même du travail, une dernière distinction apportée par Hannah Arendt mérite d’être retenue : la distinction entre propriété et richesse. Avant les temps modernes qui commencèrent par l'expropriation des pauvres, toutes les civilisations reposaient sur le caractère sacré de la propriété privée. A l'origine, être propriétaire signifiait, ni plus ni moins, avoir sa place en un certain lieu du monde et donc appartenir à la cité politique. D'origine toute différente et historiquement plus récente est la signification politique de la fortune privée d'où l'homme tire ses moyens de vivre. La richesse privée devint une condition d'admission à la vie publique non pas parce que son possesseur travaillait à l'accumuler, mais au contraire, parce qu'elle garantissait raisonnablement que ce propriétaire n'aurait pas à se consacrer à l'acquisition de ses moyens de consommation, qu'il était libre de s'adonner à des activités publiques. Jusqu'au début de l'époque moderne, on n'avait jamais tenu pour sacrée cette sorte de propriété. La richesse ne peut pas devenir commune au sens d’un monde commun. Elle resta strictement privée. Il n'y eut de commun que le gouvernement, nommé pour protéger les uns des autres les propriétaires concurrents dans la lutte pour l'enrichissement. L'évidente contradiction de cette conception moderne du gouvernement, dans laquelle les hommes n'ont en commun que leurs intérêts privés est la traduction de l'effacement total de la différence même entre domaines public et privé, l'un et l'autre résorbés dans la sphère du social.
Après avoir posé quelques distinctions majeures, entre travail, œuvre et action, entre domaine privé, domaine public et domaine social, entre propriété et richesse, et introduit le concept fondamental de monde commun, Hannah Arendt traite de chacune des modalités de l’activité humaine. Nous n’en retiendrons, bien sûr, que ce qui concerne l’objet de notre propre exploration : le travail, le monde et leur relation.
Se référant à Marx qui définit le travail comme « le métabolisme de l'homme avec la nature Hannah Arendt précise qu'il « parle physiologiquement » et que travail et consommation ne sont que deux stades du cycle perpétuel de la vie biologique. Ce cycle a besoin d'être entretenu par la consommation, et l'activité qui fournit les moyens de consommation, est l'activité de travail. Tout ce que produit le travail est fait pour être absorbé presque immédiatement dans le processus vital, et cette consommation, régénérant le processus vital reproduit une nouvelle force de travail nécessaire à l'entretien du corps. La « nécessité de subsister » régit à la fois le travail et la consommation, et le travail, lorsqu'il incorpore, rassemble et assimile physiquement les ressources que procure la nature, fait activement ce que le corps fait de façon plus intime encore lorsqu'il consomme sa nourriture.
Arendt fait remonter l'ascension soudaine et spectaculaire du travail, passant de la situation la plus méprisée à la place d'honneur et devenant la mieux considérée des activités humaines, à la « découverte » du travail comme source de la propriété, puis à l’affirmation que le travail est la source de toute richesse, enfin au « système du travail » de Marx où le travail devint la source de toute productivité et l'expression de l'humanité même de l'homme. Marx, en considérant le travail comme la plus haute faculté humaine d’édification du monde, attribuait à l’activité, le travail, qui est en fait la plus naturelle, la plus étrangère au monde, des qualités qui n'appartiennent qu'à l'œuvre. Certes, le travail apporte aussi à la nature quelque chose de l'homme, mais la proportion entre ce que donne la nature — les « bonnes choses » — et ce que l'homme ajoute est, dans les produits du travail, exactement l'inverse de ce qu'elle est dans les produits de l'œuvre. Aussi Arendt se pose-t-elle la question de savoir pourquoi Marx et ses prédécesseurs, en dépit de leur pénétration, ont voulu si obstinément faire du travail l'origine de la propriété, de la richesse, de toutes les valeurs et finalement de l'humanité même de l'homme. Ou, en d'autres termes, quelles furent les expériences inhérentes à l'activité de travail qui s'avérèrent d’une si haute importance pour les temps modernes? Historiquement, les théoriciens politiques à partir du XVIe siècle furent en présence d'un phénomène inouï d’accroissement de richesse, de propriété, d'acquisition. En essayant d'expliquer cette augmentation constante, ils remarquèrent naturellement le phénomène du processus, qui devint le concept-clef de l'époque et de ses sciences, historique et naturelles. Dès le début, ils se représentèrent ce processus, puisqu'il paraissait sans fin, comme un processus naturel et plus spécialement sous l'aspect du processus vital. La superstition la plus grossière des temps modernes — l'argent fait de l'argent — doit sa vraisemblance à la métaphore sous-jacente de la fécondité naturelle de la vie. De toutes les activités humaines seul le travail (ni l'action ni l'œuvre) ne prend jamais fin, et avance automatiquement d'accord avec la vie, hors de portée des décisions volontaires ou des projets humainement intelligibles.
Le véritable sens de la productivité du travail qui venait d'être découverte n'apparaît que dans l'œuvre de Marx, où il repose sur l'équivalence de la productivité et de la fertilité, de sorte que le fameux développement des « forces productives » de l'humanité parvenant à une société d'abondance n'obéit, en fait, à d'autre loi, n'est soumis à d'autre nécessité qu'au commandement primordial « Croissez et multipliez », dans lequel résonne la voix de la nature elle-même. La force de la vie est la fécondité. L'être vivant n'est pas épuisé lorsqu'il a pourvu à sa propre reproduction, et sa « plus-value » réside dans sa multiplication potentielle. Le naturalisme cohérent de Marx découvrit la « force de travail » comme mode spécifiquement humain de la force vitale aussi capable que la nature de créer une plus-value, un surproduit. S'intéressant presque exclusivement à ce processus, celui des « forces productives de la société », dans la vie de laquelle, comme dans la vie de toute espèce animale, la production et la consommation s'équilibrent toujours, Marx ignora complètement la question d'une existence séparée d'objets du-monde dont la durabilité résiste et survit aux processus dévorants de la vie.
Pour établir la propriété l'abondance ne peut suffire; les produits du travail ne deviennent pas plus durables quand ils sont abondants, ils ne peuvent s'entasser ni s'emmagasiner pour devenir propriété d'un homme; au contraire, ils n'ont que trop tendance à disparaître dans le processus d'appropriation ou à « périr inutilement » s'ils ne sont consommés « avant de se gâter ». Ce que les temps modernes ont défendu avec tant d'ardeur, ce n'est pas la propriété en soi, c'est l'accroissement effréné de la propriété, ou de l'appropriation; contre tous les organes qui eussent maintenu la permanence « morte » d'un monde commun, ils ont lutté au nom de la vie, de la vie de la société. Dans une société de propriétaires, à la différence d'une société de travailleurs ou d'employés, c'est encore le monde et non pas l'abondance naturelle ni la simple nécessité de vivre qui se tient au centre des préoccupations humaines. Tout devient différent si l'intérêt dominant n'est plus la propriété mais l'accroissement de richesse et le processus d'accumulation comme tel. Ce processus peut être infini comme le processus vital de l'espèce, et son infinité est constamment menacée, interrompue par le fait regrettable que les individus ne vivent pas éternellement, n'ont pas de temps infini devant eux. Il faut que la vie de la société dans son ensemble, au lieu des vies limitées des individus, soit considérée comme le gigantesque sujet du processus d'accumulation, pour que ce processus se développe en toute liberté, à toute vitesse, débarrassé des limites qu'imposeraient l'existence individuelle et la propriété individuelle. Il faut que l'homme n'agisse plus en individu, uniquement préoccupé de son existence, mais en « membre de l'espèce ». Il faut que la reproduction de la vie individuelle s'absorbe dans le processus vital du genre humain, pour que le processus vital collectif d'une « humanité socialisée » suive sa propre « nécessité », c'est-à-dire le cours automatique de sa fécondité, au double sens de la multiplication des vies et de l'abondance croissante des biens dont elles ont besoin.
La division du travail naît directement du processus de l'activité de travail et il ne faut pas la confondre avec le principe apparemment similaire de la spécialisation qui règne dans les processus de l'activité d'œuvre, comme on le fait habituellement. La spécialisation de l'œuvre et la division du travail n'ont en commun que le principe général d'organisation qui lui-même n'est lié ni à l'œuvre ni au travail, mais doit son origine à la sphère strictement politique de la vie, au fait que les hommes sont capables d'agir, et d'agir ensemble de façon concertée. C'est seulement dans le cadre de l'organisation politique, dans lequel les hommes ne se bornent pas à cohabiter mais agissent ensemble, qu'il peut y avoir spécialisation de l'œuvre et division du travail. Mais tandis que la spécialisation est essentiellement guidée par le produit fini, dont la nature est d'exiger des compétences diverses qu'il faut rassembler et organiser, la division du travail, au contraire, présuppose l'équivalence qualitative de toutes les activités pour lesquelles on ne demande aucune compétence spéciale, et ces activités n'ont en soi aucune finalité : elles ne représentent que des sommes de force de travail que l'on additionne de manière purement quantitative. La division du travail se fonde sur le fait que deux hommes peuvent mettre en commun leur force de travail et « se conduire l'un envers l'autre comme s'ils étaient un». Cette « unité » est exactement le contraire de la coopération, elle renvoie à l'unité de l'espèce par rapport à laquelle tous les membres un à un sont identiques et interchangeables.
Comme aucune des activités en lesquelles le processus est divisé n'a de fin en soi, leur fin « naturelle » est exactement la même que dans le cas du travail « non divisé » : soit la simple reproduction des moyens de subsistance, c'est-à-dire la capacité de consommation des travailleurs, soit l'épuisement de la force de travail. Toutefois, ni l'une ni l'autre de ces limites ne sont définitives; l'épuisement fait partie du processus vital de l'individu, non de la collectivité, et le sujet du processus de travail, lorsqu'il y a division du travail, est une force collective et non pas individuelle. L' « inépuisabilité » de cette force de travail correspond exactement à l'immortalité de l'espèce, dont le processus vital pris dans l'ensemble n'est pas davantage interrompu par les naissances et les morts individuelles de ses membres. Plus sérieuse, semble-t-il, est la limitation imposée par la capacité de consommation, qui reste liée à l'individu, même lorsqu'une force collective de travail a remplacé la force de travail individuelle. Le progrès de l'accumulation de richesse peut être sans limite dans une « humanité socialisée » qui s'est débarrassée des limitations de la propriété individuelle et qui a surmonté celles de l'appropriation individuelle en dissolvant toute richesse stable, toute possession d'objets « entassés » et « thésaurisés », en argent à dépenser et à consommer. Le problème est d'adapter la consommation individuelle à une accumulation illimitée de richesse. La solution paraît assez simple. Elle consiste à traiter tous les objets d'usage comme des biens de consommation, de sorte que l'on consomme une chaise ou une table aussi vite qu'une robe, et une robe presque aussi vite que de la nourriture. De tels rapports avec les objets du monde correspondent d'ailleurs parfaitement à la manière dont ils sont produits. La révolution industrielle a remplacé l'artisanat par le travail. Les objets du monde moderne sont devenus des produits du travail dont le sort naturel est d'être consommés, au lieu d'être des produits de l'œuvre, destinés à servir.
La perpétuité des processus de travail est garantie par le retour perpétuel des besoins de la consommation ; la perpétuité de la production n'est assurée que si les produits perdent leur caractère d'objets à employer pour devenir de plus en plus des choses à consommer, ou en d'autres termes, si l'on accélère tellement la cadence d'usure que la différence objective entre usage et consommation, entre la relative durabilité des objets d'usage et le va-et-vient rapide des biens de consommation, devient finalement insignifiante. Avec le besoin que nous avons de remplacer de plus en plus vite les choses de-ce-monde qui nous entourent, nous ne pouvons plus nous permettre de les utiliser, de respecter et de préserver leur inhérente durabilité; il nous faut consommer, dévorer, pour ainsi dire, nos maisons, nos meubles, nos voitures comme s'il s'agissait des « bonnes choses » de la nature qui se gâtent sans profit à moins d'entrer rapidement dans le cycle incessant du métabolisme humain. C'est comme si nous avions renversé les barrières qui protégeaient le monde, l'artifice humain, en le séparant de la nature, du processus biologique qui se poursuit en son sein comme des cycles naturels qui l'environnent, pour leur abandonner, pour leur livrer la stabilité toujours menacée d'un monde humain. Les idéaux de l'homo faber, fabricateur du monde : la permanence, la stabilité, la durée, ont été sacrifiés à l'abondance, idéal de l'animal laborans. Nous vivons dans une société de travailleurs parce que le travail seul, par son inhérente fertilité, a des chances de faire naître l'abondance; et nous avons changé l'œuvre en travail, nous l'avons brisée en parcelles minuscules jusqu'à ce qu'elle se prête à une division où l'on atteint le dénominateur commun de l'exécution la plus simple afin de faire disparaître devant la force de travail (cette partie de la nature, peut-être même la plus puissante des forces naturelles) l'obstacle de la stabilité « contre-nature », purement de-ce-monde, de l'artifice humain.
Hannah Arendt termine Condition de l’homme moderne par un dernier chapitre saisissant par son ampleur, sa culture et sa vision Nous en retenons deux de ses conclusions avant de nous interroger sur leur transposition à notre présent.
La mise en évidence du processus de la fabrication, l’insistance à tout considérer comme résultat d'un processus, caractérise nettement l'homo faber et sa sphère d'expériences. C'est, par contre, une chose toute nouvelle que l'exclusive préoccupation de l'époque moderne pour le processus aux dépens de tout intérêt pour les objets, pour les produits eux-mêmes. Le principe de l'utilité, bien qu'il se réfère clairement à l'homme, qui utilise la matière pour produire des objets, présuppose encore un monde d'objets d'usage par lequel l'homme est environné et dans lequel il se meut. La perte radicale des valeurs à l'intérieur de l'étroit système de référence de l'homo faber se produit presque automatiquement dès que l'homme cesse de se définir comme fabricant d'objets, constructeur de l'artifice humain, inventant incidemment des outils, pour se considérer principalement comme fabricant d'outils et « en particulier d'outils à faire des outils », produisant aussi incidemment des objets. Le repère ultime n'est ni l'usage ni l'utile, c'est « le bonheur », c'est l'évaluation de la peine et du plaisir éprouvés dans la production et dans la consommation, signant ainsi clairement la défaite de l’homo faber, autrement dit la défaite du monde.
Cette défaite fut suivie de l’élévation du travail au sommet de la hiérarchie des activités humaines. Arendt, en voit l’origine dans le caractère sacré de la vie, croyance héritée du christianisme. L'époque moderne ne cessa d'admettre que la vie, et non pas le monde, est pour l'homme le souverain bien; dans ses révisions et ses critiques les plus audacieuses, les plus révolutionnaires, des croyances ou conceptions traditionnelles, elle ne pensa même jamais à mettre en question ce renversement fondamental que le christianisme avait introduit dans le monde antique moribond. Lorsque l’activité humaine[1] eut perdu tout point de repère dans la contemplation[2], elle put devenir vie active au plein sens du mot ; et c’est seulement parce que cette vie active demeura liée à la vie, son unique point de repère, que le travail, processus vital et métabolisme de l’homme avec la nature, put devenir actif et déployer totalement sa fertilité. Dans l'avènement de la société, ce fut en dernière analyse la vie de l'espèce qui s'imposa. La dernière trace d'action, le motif qu'impliquait l'intérêt individuel, a disparu. Il est resté une « force naturelle », la force du processus vital, à laquelle tous les hommes avec toutes leurs activités étaient également soumis (« le processus de la pensée est lui-même un processus naturel »), et dont le seul but, à supposer qu'elle en eût un, était la perpétuation de l'espèce Homme. Aucune des facultés supérieures de l'homme n'était nécessaire désormais pour relier la vie individuelle à la vie de l'espèce; la vie individuelle fit partie du processus vital, et tout ce dont on avait besoin c'était de travailler, d'assurer son existence et celle de sa famille. Ce qui n'était pas obligatoire, imposé par le métabolisme vital devint superflu, ou tout au plus justifiable comme particularité de la vie humaine en tant que distincte d'autres vies animales Si l'on compare le monde moderne avec celui du passé, la perte d'expérience humaine que comporte cette évolution est extrêmement frappante. Ce n'est pas seulement, ni même principalement, la contemplation qui est devenue une expérience totalement dénuée de sens. La pensée elle-même, en devenant « calcul des conséquences », est devenue une fonction du cerveau, et logiquement on s'aperçoit que les machines électroniques remplissent cette fonction beaucoup mieux que nous. L'action a été vite comprise, elle l'est encore, presque exclusivement en termes de faire et de fabrication, à cela près que la fabrication, à cause de son appartenance-au-monde et de son essentielle indifférence à l'égard de la vie, passa bientôt pour une autre forme du travail, pour une fonction plus compliquée mais non pas plus mystérieuse du processus vital.
Que nous apporte aujourd’hui la connaissance de la réflexion de Hannah Arendt sur le travail à travers la retranscription personnelle que nous venons d’en donner ? Elle nous permet d’abord de comprendre les origines, la nature et les conséquences de ce que nous avons appelé « la victoire du travail et la défaite du monde » et, ensuite, de réfléchir au futur de cette situation, d’imaginer vers quoi tendre, de dégager des chemins pour y parvenir.
Le travail aujourd’hui triomphe. Il occupe la place centrale dans le discours de notre société et malheureusement, même si c’est par son absence, dans nos existences humaines. Il reste toujours lié à la nécessité, au sens le plus physiologique du terme, puisqu’il représente, pour une population qui va en s’accroissant sans cesse sur la planète, le seul moyen d’accéder aux ressources nécessaires à la vie à travers son complément inévitable, la consommation. Mais le travail s’est transformé et sa transformation révolutionnaire a modifié en trois siècles notre monde comme aucune autre activité humaine ne l’a fait.
Les origines de cette transformation, à ne pas confondre avec des causes, sont décryptées par Hannah Arendt et, en particulier, la première d’entre elles : la sortie du travail de l’obscurité du domaine privé, de la famille et son accès à la lumière du domaine public avec, à la fois cause et effet, l’apparition, de la société. Les anciennes sphères du privé et du public, et maintenant celle de l’intime, ont été dévorées de façon irrésistible par la croissance du domaine social. En un temps très court les collectivités modernes se sont transformées en sociétés de travailleurs et d’employés, dont tous les membres considèrent leur activité, quelle qu’elle soit, comme un moyen de gagner leur vie et celle de leur famille.
Nous pouvons observer cette transformation, quasiment en temps réel, avec les pays dits émergents, en particulier avec la Chine. Avec le travail, c’est le processus même de la vie, et sa fertilité qui, sous une forme ou une autre, a pénétré le domaine public. Libéré des restrictions que lui imposait sa relégation au domaine privé l’élément de croissance propre à toute vie organique a complètement dépassé les processus de dépérissement qui, dans l’économie de la nature, modèrent et équilibrent l’exubérance de la vie. Un processus inouï d’accroissement de richesse et d’accumulation a vu le jour.
Mais ce travail, assimilé à la vie, s’est transformé de façon révolutionnaire. Il s’est divisé en actes élémentaires, en tâches, en fonctions, en compétences selon le degré d’automatisation, d’informatisation. Il s’est aussi transformé en s’étendant des biens de consommation, indispensables à la vie, au sens le plus biologique du terme, aux objets d’usage qui, plus ou moins durables, constituent le monde qui nous relie et nous sépare. Il a absorbé l’œuvre, et sa spécialisation en métiers, pour la remplacer par ses processus et sa division en fonctions. Tout est devenu ou devient bien de consommation, toute activité devient travail, au sens de moyen de gagner sa vie, mais aussi au sens de processus perpétuel dans lequel l’objet produit n’est plus la finalité. Les objets d’usage, les métiers et même le monde s’évanouissent dans ce flux incessant.
Si le travail, et la vie auquel il est assimilé, triomphent, le monde est le grand perdant. En absorbant l’œuvre le travail a transformé les objets du monde moderne en produits dont le sort naturel est d'être consommés, au lieu d'être des objets d’usage destinés à servir. Il est courant, maintenant, de pointer que nos sociétés sont des sociétés du gaspillage, comme le notait dès 1958 Hannah Arendt confrontée à l’émergence d’une société de consommation toute puissante. Il est plus rare d’entendre que cette évolution menace encore plus le monde humain que la nature et la Terre elle-même. C’est qu’enfermés dans un processus exponentiel, que nous avons baptisé croissance ou développement, nous avons perdu de vue que notre existence, pour rester humaine a besoin d’un monde, artifice créé par les générations qui nous ont précédé pour nous protéger des forces destructrices du processus vital et nous permettre de vivre et d’agir ensemble.
Nous n’habitons plus un monde, fait d’objets et d’institutions durables assurant une permanence dans laquelle s’inscrivent les biographies humaines successives. Nous sommes poussés par un processus qui détruit l’idée même de présent, s’affranchit des enseignements du passé et nous conduit de façon accélérée vers l’inconnu d’un futur auquel nous sommes devenus incapables de réfléchir. Les générations qui ont terriblement souffert des totalitarismes du XXe siècle, l’âge des extrêmes si bien étudié par l’historien britannique Eric Hobsbawm, avaient compris, dans leur chair même, l’importance de l’existence et de l’entretien d’un monde humain. Hannah Arendt, bien que ou parce que rejetée comme apatride de ce monde, mettait au premier plan le souci, l’amour du monde et en faisait le principe d’éducation majeur. La démarche du Conseil National de la Résistance française, à travers son programme adopté le 15 mars 1944, et celle des étudiants américains des « Students for a Democratic Society », à travers leur déclaration de Port Huron en 1962, obéissaient au même souci. Nous avons oublié leurs leçons pour nous courber chaque jour un peu plus sous le joug d’une nécessité toujours croissante.
Pour préciser la question débattue je vous propose 11 points de vue, 11 questionnements, autour du travail, complétant le texte d’introduction.
- Tout d’abord celui d’André Gorz, philosophe, écrivain et journaliste qui en 1988 s’interroge sur les métamorphoses du travail et élabore une critique de la raison économique. Le travail en crise ?
- Celui de Dominique Méda. Agrégée de philosophie et professeure à l’Institut d’Études politiques de Paris, elle consacre en 1995 un livre au travail, valeur en voie de disparition. Avec elle nous oserons nous interroger sur le travail, son statut et surtout son sens. Question occultée par son traitement technocratique, économique et politicien et à laquelle elle applique l’analyse critique et réflexive de la philosophie.
- Celui du sociologue et historien américain Richard Sennett. Son livre publié en 1998 et traduit en 2000 sous le titre, Le travail sans qualité, introduit une question originale : le travail ne corroderait-il pas le caractère ?
- Celui de l’économiste Philippe Askenazy, traitant en 2004 des désordres du travail et enquêtant sur le nouveau productivisme à leur origine. Ne faudrait-il pas reposer le travail ?
- Celui de Bruno Flacher, agrégé et enseignant en sciences sociales, consacrant en 2008 un livre au thème : Travail et intégration sociale. Avec la question suivante : quels liens établir entre travail et citoyenneté ?
- Celui d’Yves Clot, professeur et titulaire de la chaire de psychologie des milieux de travail et de vie. De son livre – Le travail sans l’homme ? – nourri d’enquêtes de terrain et faisant référence depuis sa première publication en 1995, nous extrayons une question de la postface de 2008 : bien travailler aujourd’hui ne demande-t-il pas d’avoir le loisir dans le travail même de penser et repenser ce que l’on fait ?
- Celui de la sociologue québécoise Rolande Pinard. De son livre de 2008 – La révolution du travail. De l’artisan au manager – nous tirons une question en forme de remarque, ou l’inverse : ne serait-ce pas plutôt le travail qui est devenu superflu que nous ?
- Celui du philosophe et réparateur de motos américains Matthew B. Crawford. Dans son Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail, publié en 2009 et traduit en 2010, il nous amène à la question : qu’est-ce qu’un bon travail ? Rejoignant, par un parcours très différent, le souci d’un monde durable d’Arendt.
- Celui du philosophe et écrivain suisse, vivant à Londres et écrivant en anglais, Alain de Botton. Dans son superbe livre, publié en 2009 et traduit en 2010, à la fois essai et reportage photographique – Splendeurs et misères du travail – il s’interroge sur la croyance spécifique à notre société que le travail doit nous rendre heureux. Le bonheur par le travail ?
- En 2010, Florence Aubenas, grand reporter et ancienne otage en Irak, publie un livre remarquable et remarqué – Le quai d’Ouistreham – sur sa recherche pendant six mois d’un CDI à Caen. Livre à lire absolument comme radiographie de la condition actuelle de beaucoup des travailleurs et, ici, des travailleuses. Le CDI, un nouvel eldorado ?
- Enfin le point de vue de Bernard Stiegler. Dans un entretien réalisé en 2015, alors qu’il écrivait le premier volume de La société automatique, et publié sous le titre L’emploi est mort, vive le travail, il se fait le défenseur d’un nouveau modèle du travail. Celui des intermittents, celui de l’intermittence, associé à l’expérimentation de ce qu’il appelle un revenu contributif. L’intermittence comme modèle ?
C'est dire que ce que les Anglo-Saxons et les Allemands appellent « l'éthique du travail » et la « société de travail » sont choses récentes.
Le propre des « sociétés de travail », c'est que le travail y est considéré tout à la fois comme un devoir moral, comme une obligation sociale et comme la voie vers la réussite personnelle. L'idéologie du travail tient pour acquis :
- que plus chacun travaille, mieux tout le monde s'en trouve ;
- que ceux qui travaillent peu ou ne travaillent pas portent un préjudice à la collectivité et ne
- méritent pas d'en être membres ;
- que qui travaille bien réussit socialement et que qui ne réussit pas en porte lui-même la faute.
Beaucoup d'entre nous restent profondément imprégnés par cette idéologie et il n'est pas de jour qu'un homme politique, de droite ou de gauche, ne vienne nous exhorter au travail en affirmant que c'est par le travail que nous surmonterons la crise présente. Pour « vaincre le chômage », ajoute-t-on, il faut travailler plus et non pas moins.
En réalité, l'éthique du travail est devenue caduque. Il n'est plus vrai que, pour produire plus, il faut travailler plus, ni que produire plus conduit à vivre mieux.
Le lien entre plus et mieux est rompu ; car pour beaucoup de produits ou services nos besoins sont largement couverts, tandis que beaucoup de nos besoins insatisfaits seront comblés non pas en produisant plus, mais en produisant autrement, autre chose, voire en produisant moins. Cela vaut, en particulier, pour nos besoins d'air, d'eau, d'espace, de silence, de beauté, de temps, de contacts humains.
Il n'est plus vrai non plus que plus chacun travaille, mieux tout le monde s'en trouve. La crise présente a impulsé une mutation technique d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent : la « révolution micro-électronique ». Celle-ci a pour effet et pour but des économies de travail rapidement croissantes, dans l'industrie aussi bien que dans les administrations et services. Des productions croissantes y sont assurées avec des quantités de travail décroissantes. Il en résulte que le processus social de production n'a plus besoin que tout le monde y travaille à plein temps. L'éthique du travail en devient impraticable et la société de travail est en crise.
Tout le monde n'est pas conscient de cette crise ; certains en sont conscients mais ont intérêt à la nier. C'est le cas, en particulier, de nombreux « néo-conservateurs ». Ils tiennent à perpétuer l'idéologie du travail dans un contexte où le travail payé devient de plus en plus rare. De la sorte, ils poussent les personnes à la recherche d'un travail payé à se concurrencer de plus en plus durement les unes les autres. De cette concurrence, ils attendent que le prix du travail (c'est-à-dire le salaire) baisse et que les « forts » éliminent les « faibles ». De cette sélection néo-darwinienne des « plus aptes », ils espèrent la renaissance d'un capitalisme dynamique, débarrassé de ses scories et de tout ou partie des lois sociales.
L'intérêt commun des salariés est, au contraire, de ne pas se concurrencer, d'organiser leur union face au patronat et de négocier collectivement avec lui les conditions de leur emploi. Le syndicalisme est l'expression de cet intérêt commun.
Dans un contexte où il n'y a pas de travail payé à plein temps pour tout le monde, l'abandon de l'idéologie du travail devient pour le mouvement syndical un impératif de survie. Cet abandon n'est en rien un reniement. Le thème de la libération du travail, de même que le thème du « travailler moins pour travailler tous » ont motivé les luttes du mouvement ouvrier depuis ses origines.
Par « travail », nous avons pris l'habitude d'entendre une activité payée, accomplie pour le compte d'un tiers (l'employeur), en vue de fins qu'on n'a pas choisies soi-même et selon des modalités et des horaires fixés par celui qui vous paie. La confusion entre « travail » et « emploi » est courante, de même que la confusion entre « droit au travail », « droit à un salaire », et « droit à un revenu ».
Or, en réalité, toute activité n'est pas du travail et tout travail n'est pas payé ni effectué en vue d'un paiement. Il convient de distinguer trois types de travail :
Le travail qu'on accomplit en vue d'un paiement. C'est l'argent, c'est-à-dire l'échange marchand qui est alors le but principal. On travaille d'abord pour « gagner sa vie » et ensuite seulement pour la satisfaction ou le plaisir que, le cas échéant, on retire de ce travail. Nous appellerons celui-ci travail à but économique.
Le travail qu'on accomplit non pas en vue d'un échange marchand mais en vue d'un résultat dont on est soi-même, directement, le principal destinataire et bénéficiaire. C'est là le cas, entre autres, du « travail de reproduction », c'est-à-dire du travail domestique qui, jour après jour, assure les bases nécessaires immédiates à la vie : préparer les aliments, veiller à la propreté de son corps et de son logement, mettre au monde et élever des enfants, etc. Ce travail a été et est encore souvent imposé aux femmes en plus du travail à but économique.
Par le fait que la communauté domestique (famille ou famille élargie) est une communauté de vie fondée sur la mise en commun et non sur la comptabilisation et l'échange marchand, le paiement du travail domestique n'a pas été envisagé jusqu'à ces derniers temps. Le travail domestique a, au contraire, été considéré comme un travail fait par et pour la communauté domestique indivise. Cette façon de voir, il faut le souligner, n'est légitime que si les membres de la communauté domestique se partagent équitablement les tâches. Le paiement du travail domestique moyennant une allocation publique que certaines militantes réclament pour la femme, au nom de l'utilité sociale de ce travail, ne peut pas conduire à un partage équitable des tâches et présente en outre les inconvénients suivants :
- il transforme le travail domestique en travail à but économique, c'est-à-dire en emploi (de) domestique ;
- il assimile le travail domestique à un travail utile à la société, alors que son but est et doit être non pas l'utilité sociale mais le bien-être et l'épanouissement personnel des membres de la communauté, ce qui est fort différent. La confusion entre l'épanouissement des personnes et leur utilité sociale relève d'une conception totalitaire de la société dans laquelle il n'y a pas de place pour la singularité et l'unicité de chaque personne ni pour la spécificité de la sphère privée. Celle-ci est et doit être par essence soustraite au contrôle social et aux critères d'utilité publique.
Les activités autonomes qu'on accomplit comme étant une fin en elles-mêmes, librement, sans nécessité. Il s'agit là de toutes les activités éprouvées comme épanouissantes, enrichissantes, sources de sens et de joie : activités artistiques, philosophiques, scientifiques, relationnelles, éducatives, charitables, d'entraide, d'autoproduction, etc. Toutes ces activités requièrent un « travail » portent leur sens et leur récompense dans leur accomplissement autant que dans leur résultat : elles ne font qu'un avec le temps de vivre. Encore faut-il que celui-ci ne soit pas chichement mesuré. En effet, une même activité — par exemple élever des enfants, préparer un repas, prendre soin du cadre de vie — peut être un travail dont on subit les contraintes comme oppressives ou une activité à laquelle on prend plaisir, selon qu'on est harassé par le manque de temps ou qu'on l'accomplit tout à loisir, dans la coopération et le partage volontaires des tâches.
Le travail à but économique n'est devenu progressivement dominant qu'avec le capitalisme et la généralisation des échanges marchands. Il a éliminé, en particulier, beaucoup d'échanges de services non marchands et de productions artisanales dans lesquelles le travail à but économique et le plaisir de créer du beau étaient inextricablement mêlés. C'est pourquoi le mouvement ouvrier a originellement contesté la primauté que le capitalisme industriel conférait au travail salarié et aux buts économiques. Réclamant l'abolition du salariat et le gouvernement ou auto-gouvernement de la société par les travailleurs librement associés, maîtres des moyens de production, la contestation ouvrière allait toutefois à contresens du développement en cours. Elle avait un caractère utopique, car les possibilités de lui donner corps ne se dessinaient pas.
Or ce qui était utopique au début du siècle dernier cesse en partie de l'être aujourd'hui : le processus social de production, l'économie requièrent de moins en moins de travail salarié. La subordination au travail salarié et aux buts économiques de toutes les autres activités et fins humaines perd son sens et sa nécessité. L'émancipation par rapport à la rationalité économique et marchande devient possible. Elle ne se réalisera que par des actions qui non seulement la prennent expressément pour but mais en illustrent la possibilité. L'action culturelle, le développement d'« activités alternatives » prennent une importance toute particulière dans ce contexte.
[1] Métamorphoses du travail, critique de la raison économique, André Gorz, foliosessais n°441, Éditions Galilée, 1988, p. 343-350.
L'objectif de ce livre n'est ni de présenter une nouvelle théorie du travail censée régler les problèmes que connaissent aujourd'hui, à des degrés divers, les pays industrialisés, ni d'enrichir la galerie des systèmes philosophiques. Il est bien plutôt de ramener à la surface — et donc de rendre disponibles pour le débat public — un certain nombre de réflexions, anciennes ou récentes, de nature philosophique sur le travail, et de développer ainsi une approche critique de cette notion.
Nous appartenons depuis peu de temps (moins de deux siècles) à des sociétés fondées sur le travail. Ce qui signifie que le travail, reconnu comme tel par la société, c'est-à-dire rémunéré, est devenu le principal moyen d'acquisition des revenus permettant aux individus de vivre, mais qu'il est aussi un rapport social fondamental — Mauss aurait dit un fait social total — et enfin le moyen jamais remis en question d'atteindre l'objectif d'abondance. Aujourd'hui seulement, alors que le fonctionnement normal de nos sociétés — le plein emploi à temps plein pour tous — est remis en cause, nous pouvons nous en rendre compte et la possible diminution ou raréfaction du travail bouleverse soudain ce que nous tenions pour des évidences.
Des auteurs peu nombreux ont développé depuis quelques années une analyse ambitieuse visant à replacer le travail dans l'histoire des idées, des représentations et des civilisations, et ont tenté de s'interroger sur la signification du travail dans nos sociétés modernes. Mais, la plupart du temps, la question du chômage reste une question traitée par des experts, le plus souvent économistes de formation, qui cherchent à relancer la machine et à faire disparaître cette anomalie qu'est le sous-emploi. Or, parce qu'il est au centre d'une constellation très intégrée — Louis Dumont aurait dit d'une idéologie — et parce que la place qu'il occupe aujourd'hui dans nos sociétés va de pair avec de nombreux autres phénomènes qui nous apparaissent comme des évidences, voire comme des données naturelles ou de fait (par exemple, la place de l'économie ou la prédominance de la rationalité instrumentale), la compréhension exacte du rôle que joue le travail dans nos sociétés nécessite non seulement une approche multidisciplinaire, capable de saisir la cohérence d'ensemble de ces diverses manifestations, mais aussi, et surtout, nous semble-t-il, l'intervention de la plus généraliste et de la plus réflexive de toutes les sciences dites humaines, la philosophie.
Telle est la seconde ambition de ce livre : démontrer que l'analyse critique et réflexive développée par la philosophie est plus que jamais nécessaire à notre temps, en particulier pour nous aider à resituer des notions — que nous croyions bien connues — dans l'histoire des idées et des représentations ainsi qu'à reformuler un certain nombre de questions contemporaines. Cette ambition paraîtra peut-être démesurée, mal à propos, et surtout profondément datée. Certains de nos philosophes eux-mêmes ont en effet glosé sur la fin de la philosophie, c'est-à-dire sur les vaines ambitions d'un certain mode de pensée, volontairement généraliste et aux antipodes du type de savoir qui s'est développé depuis le début du XXe siècle. Dans la grande querelle des sciences de la nature et des sciences de l'esprit qui a émaillé à plusieurs reprises le XIXe et le XXe siècle, ce sont les sciences « opérationnelles » qui l'ont emporté, celles qui présentaient des garanties à la fois en matière de vérification expérimentale et en termes d'utilité. Le modèle développé par le positivisme logique, qui voulait que l'on n'appelât sciences que les ensembles de raisonnements hypothético-déductifs susceptibles d'être vérifiés et falsifiés, semble s'être définitivement imposé contre les sciences plus généralistes incapables d'exhiber leurs fondements, de démontrer l'exactitude de leurs propos ou de montrer en quoi elles se démarquaient des idéologies. La philosophie semble avoir été la principale victime de ce développement, du moins la métaphysique (cible privilégiée du positivisme logique) ou la critique.
La philosophie s'est aujourd'hui enfermée dans la contemplation et l'élaboration toujours recommencée de son histoire. Même Heidegger, le dernier « grand philosophe », s'est bien gardé de traiter des problèmes dits « de société », dans son œuvre du moins, au point de condamner ceux qui, en France, avaient tenté d'utiliser sa philosophie pour prôner l'engagement. La philosophie actuelle, celle qui s'enseigne dans les terminales et dans les universités ou celle qui s'écrit dans les livres, demeure le plus souvent une histoire des idées conçue comme un défilé rationnel de doctrines se succédant logiquement les unes aux autres sans que jamais la relation soit faite avec l'histoire réelle. Quant à la possibilité pour elle de s'exprimer sur les questions dites de société (le chômage, le travail, l'éducation), elle s'en garde bien, de peur de tomber dans les défauts qui lui ont déjà été reprochés. La philosophie chemine ainsi dans un étroit chenal bordé de deux principaux écueils : la tentation normative et l'idéologie — ou sa version neutre, le relativisme. Dès lors, mieux vaut se spécialiser dans le commentaire. Quant à exercer une fonction purement critique, la philosophie s'y est bien essayée depuis Kant, en particulier avec l'école de Francfort, mais cette manière de procéder n'a fait d'émules qu'en Allemagne et ceux-ci demeurent peu nombreux. Malgré la demande de sens dont notre époque est avide, nous continuons à exiger des non-spécialistes qui se risquent à un discours général qu'ils indiquent « d'où ils parlent », c'est-à-dire qu'ils dévoilent les intérêts qu'ils représentent, puisque nous sommes tous censés savoir qu'il est aujourd'hui impossible de tenir un discours universel ou même de mener une discussion véritablement raisonnée.
La fonction critique que la philosophie exerçait à une époque aurait pu être prise en charge par les autres sciences humaines, qui après tout se sont bien développées sur ses décombres, en particulier la sociologie. Mais, devant l'offensive du positivisme anglo-saxon et des caractéristiques de la demande politique et sociale retraduite par l'État, cette discipline s'est adaptée aux canons de scientificité qu'on lui reprochait de ne pas respecter et se garde bien aujourd'hui, sauf exceptions, de tenir le moindre discours trop généraliste, normatif ou critique. La référence à une norme, à une éthique, à des choix est devenue, pour toutes les sciences humaines, ce qu'il faut à tout prix éviter. Ce qui nous conduit à la situation suivante : d'un côté, des professeurs, chercheurs, écrivains enseignent la philosophie, l'histoire des idées, la théorie politique, censées permettre aux individus d'exercer leur raison et leur faculté critique ; de l'autre, les responsables des institutions politico-sociales au sens large, c'est-à-dire des politiques publiques, gèrent la machine sociale en se gardant bien d'attribuer à son mouvement des fins autres que la pure reproduction de celui-ci. Il ne s'agit pas de dire que les intellectuels ont disparu ou que les responsables publics n'ont aucune idée. Au contraire, chacun a sa « petite idée », mais chacun se garde de la divulguer, car elle relève de la conviction intime. Qui donc exerce aujourd'hui, dans nos pays hautement développés, la fonction critique ? Sur quels principes, sur quelles croyances se fondent les responsables de nos politiques, qu'il s'agisse des hauts fonctionnaires, des hommes politiques ou de tous ceux qui, un jour, participent à la régulation sociale ?
Une manière de le savoir serait de connaître ce qu'ils ont lu, comment ils ont été formés, ou encore sur quel terreau poussent et se développent les idées politiques ou les théories qui périodiquement sont reprises par toute une partie de la classe dirigeante puis diffusées dans l'ensemble du corps social. Un certain nombre de nos responsables possèdent des connaissances en théorie sociale, en histoire des idées, mais n'y font généralement pas appel pour exercer leur tâche quotidienne. En revanche, ils mobilisent des connaissances économiques, souvent érigées en recettes et en dogmes, mêlées de quelques éléments d'histoire économique, de quelques principes de théorie politique et de lectures générales, mais qu'ils s'estiment indignes de critiquer. La formation des grandes écoles qui mènent à ces responsabilités l'explique : Polytechnique, l'ENA, les écoles d'ingénieurs ou de commerce en restent à un assez grand niveau de généralités en matière d'histoire des idées, alors qu'elles poussent à l'acquisition de connaissances techniques et spécialisées approfondies.
Où s'exerce la fonction critique dans nos sociétés si le discours généraliste et intellectuel est condamné comme idéologique ou irréaliste et si ceux qui ont quelque pouvoir n'ont pas eu l'occasion de prendre le temps de la réflexion ou bien considèrent que cela n'entre pas dans leurs prérogatives officielles? Nulle part, ou dans les lieux dépourvus d'efficacité que sont l'intériorité, les amphithéâtres des universités ou les laboratoires de recherche. Peut-elle d'ailleurs encore véritablement s'exercer alors que la plupart des sciences humaines, se gardant comme de la peste d'être normatives, le sont pourtant sans le savoir ? Le débat public lui-même est-il possible alors même que ceux qui disposent des données nécessaires — les responsables de l'État — sont tenus par l'obligation de réserve, que le reste de la population est dépourvu de cette information et que les partis politiques sont devenus incapables d'être des lieux de formation de l'opinion et de mise en évidence des enjeux, tenus qu'ils sont par l'impératif de l'élection ? Cette situation — la séparation des deux fonctions critique et gestionnaire, la méfiance à l'égard de la fonction critique et normative et l'absence d'un véritable espace public — est relativement inquiétante, sauf si l'on pense, comme beaucoup de bons esprits aujourd'hui, que la société n'a besoin de rien d'autre que de son propre mouvement, et surtout pas d'une réflexion critique pour se maintenir en l'état. Mais peut-être cette idée mérite-t-elle elle-même un regard critique, voire une approche généalogique. Car si l'on ne peut certainement pas déterminer dans sa totalité la direction de la machine sociale, peut-être nos sociétés sont-elles néanmoins assez mûres, ou les risques attachés à une option fataliste trop grands, pour tenter de voir s'il ne leur serait pas possible d'infléchir cette direction. « Sapere aude », « Ose savoir » ce défi que Kant lançait à l'individu en inaugurant l'ère des Lumières, ne faut-il pas le destiner aujourd'hui à la société tout entière? Plus simplement, il s'agit de savoir si la marche de nos sociétés est entièrement déterminée de l'extérieur, comme on tente de nous le faire croire, c'est-à-dire par la mondialisation des échanges, l'internationalisation des relations et des communications, l'évolution économique, et si nous devons dès lors adopter sans même les choisir les critères économiques et technocratiques standards, partagés par tous les pays et censés nous permettre de nous « maintenir à niveau », ou bien si nous ne disposons pas plutôt d'une capacité de décider en partie des évolutions de nos sociétés et en particulier de la nôtre. Reste-t-il une place pour le choix des fins — ce que l'on avait coutume d'appeler politique ? Reste-t-il un espace, à inventer ou à redécouvrir, spécifiquement politique, pour discuter et décider collectivement de ces fins ?
La place du travail dans nos sociétés est un élément d'explication de la situation qui est la nôtre aujourd'hui — dont les deux caractéristiques sont la prédominance de l'approche économique et la recherche d'une régulation toujours plus automatique des phénomènes sociaux —, en même temps que le moyen pour nous de recouvrer une nouvelle dignité. Pour cette raison, la question du travail, de son avenir, de son statut et de sa place n'est pas et ne doit pas être l'apanage des seuls économistes. Bien au contraire, elle ne peut être tranchée — comme celle du chômage — que collectivement, consciemment et au terme d'une véritable entreprise généalogique, qui seule nous permettra de comprendre comment l'avènement des sociétés fondées sur le travail, la prédominance de l'économie et le dépérissement de la politique ne sont que les manifestations multiples d'un unique événement.
[1] Le travail, une valeur en voie de disparition, Dominique Méda, Champs/Flammarion, 1995, p. 7-13
L'expression « capitalisme flexible » décrit aujourd'hui un système qui est plus qu'une variation sur un thème ancien. L'accent porte sur la flexibilité tandis que sont dénoncées les formes rigides de la bureaucratie et les fléaux de la routine aveugle. On demande aux travailleurs de faire preuve de souplesse, d'être prêts à changer sans délai, de prendre continuellement des risques, de s'en remettre toujours moins aux règlements et aux procédures formelles.
Il est on ne peut plus naturel que la flexibilité suscite l'inquiétude : les gens ne savent pas quels risques vont payer ni quelles voies ils doivent suivre. Pour laver l'expression « système capitaliste » de l'opprobre qui lui est attaché, on a vu se propager par le passé maintes circonlocutions telles que le système de la « libre entreprise » ou de l'« entreprise privée ». De nos jours, la flexibilité n'est qu'une autre manière d'éviter au capitalisme le reproche d'oppression. En s'en prenant à la rigidité bureaucratique et en mettant l'accent sur le risque, assure-t-on, la flexibilité donne à chacun plus de liberté de façonner sa vie. En réalité, l'ordre nouveau ne se borne pas à abolir les règles du passé : il leur substitue de nouveaux contrôles qui sont cependant difficiles à comprendre. Le nouveau capitalisme est un régime de pouvoir souvent illisible.
L'aspect le plus déroutant de la flexibilité est peut-être son impact sur le caractère personnel. Les anglophones d'aman et les écrivains, depuis l'Antiquité, ne doutaient pas le moins du monde du sens du mot « caractère » : le caractère est la valeur éthique que nous attachons à nos désirs et à nos relations avec les autres. Le caractère d'un homme, écrit Horace, dépend de ses liens avec le monde. En ce sens, ce mot couvre un champ sémantique plus large que son rejeton plus moderne, la « personnalité », qui désigne les désirs et les sentiments couvant en chacun de nous à l'abri des regards indiscrets.
Le caractère a des accointances particulières avec l'évolution à long terme de notre expérience émotionnelle. Il s'exprime par la loyauté et l'engagement mutuel, à travers la poursuite d'objectifs à long terme, ou encore par la pratique de la gratification différée au nom d'une fin plus lointaine. De la confusion des sentiments qui est notre lot à tous à chaque instant, nous cherchons à en sauver et à en cultiver certains ; ce sont ces sentiments cultivables qui vont nourrir nos caractères. Le caractère se rapporte donc aux traits de personnalité que nous apprécions le plus en nous et par lesquels nous cherchons à être appréciés par les autres.
Comment décider de ce qui a une valeur durable pour nous dans une société impatiente, qui ne s'intéresse qu'à l'immédiat ? Comment poursuivre des objectifs à long terme dans une économie consacrée au court terme ? Comment cultiver des loyautés et des engagements mutuels au sein d'institutions qui sont constamment disloquées ou perpétuellement refaçonnées ? Telles sont les questions que pose le néocapitalisme de la flexibilité quant au caractère.
L’éditeur indique en note : Le développement qui suit ne se comprend que si l'on considère le titre original anglais de l'ouvrage de R. Sennett, impossible à rendre en français : The Corrosion of Character. The Personal Conséquences of Work in the New Capitalism.
Sur l'ensemble de ces questions, les acteurs se tournent vers les sciences de l'homme et de la société. La sociologie se borne par nature à de stimulants diagnostics ; seules l'économie et la psychologie s'aventurent dans le champ ardu des propositions. En France, l'absence d'«école» équivalente à l’Industrial Relations anglo-saxonne ou à la Démocratie industrielle Scandinave fait que les économistes de l’ «action» sont plus souvent spécialistes des salaires, des flux de main-d'œuvre ou de l'emploi, que du travail à proprement parler. De fait, le monde du travail est, par défaut, abandonné aux psychologues qui offrent principalement des solutions individuelles pour s'adapter au travail d'aujourd'hui. Les ingénieurs et les ergonomes sont moins écoutés ; plus que le taylorisme, c'est Taylor qui est mort.
Cet ouvrage avait l'ambition de reconstituer un chaînon manquant : le réexamen socio-économique d'une vieille question, celle des rapports du capitalisme avec le travail. Plusieurs conclusions s'imposent. Premièrement, les conditions de travail sont un problème économique et même macroéconomique, compte tenu du coût actuel des accidents et maladies du travail, et de l'impact de la santé et de la sécurité au travail sur des travailleurs appelés à partir de plus en plus tard à la retraite. Deuxièmement, la dégradation des conditions de travail, réelle, est directement liée à la diffusion du nouveau productivisme dans les entreprises. Troisièmement, cet aspect délétère est le résultat d'une prise en compte insuffisante, par les employeurs, de la santé et de la sécurité au travail. Contrairement à une idée reçue, ces derniers disposent généralement de marges de manœuvre importantes pour améliorer le sort de leurs salariés. L'effondrement des fréquences d'accidents et de maladies du travail aux États-Unis dans la dernière décennie en est la spectaculaire illustration. Deux équilibres microéconomiques sont donc possibles pour les entreprises : une coûteuse politique de prévention assurant de bonnes conditions de travail, ou bien une absence de prévention, des conditions de travail dégradées qui induisent des gaspillages humains et financiers — absentéisme, démotivation, maladies et accidents du travail.
Quatrièmement, le premier équilibre est socialement optimal. Pourtant, aujourd'hui, une majorité d'entreprises, à l'instar de leurs homologues américaines il y a dix ans, restent enfermées dans le second. La mécanique libérale, notamment dans la diffusion de l'information, a néanmoins incité les entreprises américaines à changer d'équilibre sans obérer leurs performances financières. Les institutions françaises, voire européennes, semblent malheureusement incapables de fournir des incitations suffisantes pour stopper le processus et inverser les tendances. La question du travail doit donc revenir au centre du débat social pour déterminer les moyens d'action les plus pertinents afin de rénover les conditions de travail : mobilisation des salariés, pressions syndicales, liberté de diffusion des informations ou encore réformes de la Sécurité sociale pour faire payer aux entreprises le coût réel de leur dangerosité.
[1] Les désordres du travail, enquête sur le nouveau productivisme, Philippe Askenazy, La République des Idées, Éditions du Seuil, 2004, p. 93-95
Le lien politique unit des égaux. Dans la cité grecque, la citoyenneté pouvait être pleinement exercée par ceux qui n'étaient pas assujettis à l'obligation de produire pour autrui, ni contraints de s'insérer dans des relations de service et de dépendance. Bénéficier du travail de ses esclaves ou recourir à une certaine austérité matérielle permettait de disposer de la liberté d'esprit et du loisir de délibérer. Les citoyens égaux étaient des citoyens disponibles. Si cette idée d'égalité est toujours le principe générateur de la démocratie, elle suppose moins l'oisiveté que le travail : avoir un travail installe les citoyens dans une relative égalité, celle de ceux qui ne sont pas assujettis à autrui, pas en situation de dépendance.
La dignité du citoyen consiste dans le fait d'être dépositaire d'une part égale de la souveraineté populaire, celle du travailleur réside dans l'autonomie qu'il acquiert. Mais l'activité productive ne permet pas cependant de subsumer, à l'instar de la citoyenneté, toutes les appartenances religieuses, sociales, familiales, régionales. Elle contient, en effet, l'appartenance sociale et n'émancipe du poids de la domination économique que si des droits deviennent constitutifs du contrat de travail.
La pleine citoyenneté est pluridimensionnelle. Elle n'est pas seulement civile (avec les libertés et les droits attachés à la personne) ni seulement politique, elle a aussi une dimension sociale. Le défaut de droits sociaux ampute non seulement une dimension de la citoyenneté, mais il prive aussi la citoyenneté politique d'un de ses ressorts essentiels. Le sentiment d'appartenance à la même communauté politique ne peut être fort si la solidarité ne trouve pas à se concrétiser dans des droits sociaux. Une société très clivée est aussi grosse d'antagonismes durables. Le sentiment d'égale dignité ne se nourrit pas des seuls principes généraux auxquels se réfèrent les constitutions démocratiques ; c'est pourquoi le fait de se sentir relégué ou de souffrir d'une absence de reconnaissance sociale éloigne de la vie politique ou porte à se réfugier dans des attitudes de raidissement protestataire.
Mais la citoyenneté politique peut être en elle-même une ressource et un levier pour ceux qui ne disposent pas de l'intégration sociale par le travail. Elle est une ressource concrète par les droits qu'elle offre avec le bulletin de vote et plus largement les droits d'expression et de manifestation. La participation politique ne se résume pas au vote ; elle s'exprime aussi par l'usage des droits d'organisation qui rendent possible l'émergence et la structuration des mouvements sociaux; les mouvements de chômeurs en sont une illustration. Elle est aussi une ressource symbolique : le sentiment d'appartenance à la même communauté politique nourrit l'idée des droits-créances. Les initiateurs des mouvements de chômeurs ont, par exemple, fait largement référence au préambule de la constitution où est inscrit le principe du droit au travail.
Affirmer aujourd'hui le droit au travail c'est affirmer un droit à l'existence sociale par le salaire. Louis Blanc n'est plus là pour proposer la mise en place des ateliers nationaux. Si le droit au travail suppose aujourd'hui la croissance économique, il réclame aussi le droit du travail. Celui-ci contribue à créer, dans une économie de marché, les conditions d'une « saine » concurrence, celle qui n'accorde pas une prime au « moins-disant social ». Cela implique le plein respect des règles produites par la loi et la négociation collective. Si, comme le proclamait Félix Pyat en novembre 1848, « le droit au travail, c'est le droit de vivre en travaillant », le respect du droit du travail garantit la possibilité pour ceux qui ont un travail d'en vivre, de ne pas tomber dans le nouveau paupérisme des bad jobs; le droit du travail est aussi protecteur de l'emploi existant et créateur de nouveaux emplois en éliminant le surtravail.
« Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère », affirmait Henri Lacordaire.
[1] Travail et intégration sociale, Bruno Flacher, Bréal, 2008.
Au vu des résultats obtenus dans la série d'interventions qui ont suivi les enquêtes utilisées dans ce livre, dans les secteurs les plus variés, on peut retenir le diagnostic paradoxal suivant : l'intensification du travail a progressé malgré tout dans beaucoup de secteurs d'activité. Mais, sous le masque d'une mobilisation de tous les instants, pour beaucoup de travailleurs, une immobilisation psychique insidieuse fait trop souvent son nid. D'un côté, s'avance une sorte d'« externalisation de la respiration », figure moderne du travail « en apnée ». Mais, de l'autre, cette suractivité ressemble de plus en plus à un engourdissement social et psychologique. Le travail est « malade », enflammé et éteint à la fois. Gâté par le manque d'air, il essouffle ceux qui travaillent sans pour autant reposer les autres, ceux qui sont livrés à la respiration artificielle des appareils du chômage de masse.
De plus, ce loisir-là ne « s'externalise » pas sans risques. Quand l'activité professionnelle manque de respiration, elle mit par empoisonner la vie entière. Elle a le bras long. Ce qui s'y trouve empêché intoxique les autres domaines de l'existence. Alors, le « temps libre », refoulé « hors travail », vire au temps mort. Quand l'activité ordinaire se trouve systématiquement contrariée, ravalée et finalement désaffectée, la vie au travail, d'abord impensable, devient indéfendable aux yeux de ceux qui s'y livrent. Ils peuvent alors être gagnés par un sentiment de futilité et d'insignifiance. Ainsi s'explique que la suractivité professionnelle soit compatible avec une certaine forme de désœuvrement psychologique. Au-delà d'un seuil, l'intensification factice du travail laisse la vie en jachère en la privant paradoxalement de toute intensité réelle. C'est là la source essentielle du malaise actuel dans le travail.
Car la valeur du travail réalisé chaque jour ne réside pas seulement dans ce qui est fait mais dans ce qu'on peut apprendre chaque fois en le faisant et dans ce qu'on imagine pouvoir essayer encore en le refaisant. Alors seulement on s’y retrouve. Sans doute ce loisir-là n'est-il pas de tout repos. Car il n'est un dégagement à l'égard de l'organisation du travail qu'au prix d'un engagement dans une autre histoire que l'histoire personnelle de chacun. Ce temps libre n'est pas libéré de l'effort. Car c'est un effort pour ceux qui travaillent d'inscrire leur activité propre dans la mémoire collective d'un milieu. Mais c'est là ce qui rend le travail défendable à leurs propres yeux, ce qui fait qu'une vie professionnelle vaut d'être vécue. Pouvoir se sentir comptable d'une mémoire professionnelle, lot commun du travail, d'où chacun peut tirer quelque chose et où il peut déposer ce qu'il a trouvé, est un ressort subjectif très actif dans le travail contemporain. C'est d'autant plus vital que l'objet de l'activité s'éloigne de la chose industrielle qui, en quelque sorte, la lestait. Le mauvais traitement de cet arrimage à une histoire collective dans laquelle on peut se reconnaître est sans aucun doute à l'origine de beaucoup de situations professionnelles pathogènes.
[1] Le travail sans l’homme ? Pour une psychologie des milieux de travail et de vie, Yves Clot, La Découverte, 1995-2008, p. 267-269.
C'est le travail qui est devenu superflu, pas nous. Dire que le travail superflu rend l'homme superflu, c'est accepter l'idée que nous soyons, comme êtres humains, réductibles au travail ou, pis, à l'emploi. Le travail n'offre aucune valeur intrinsèquement positive, aucune connotation de citoyenneté (si ce n'est la citoyenneté organisationnelle). Dans le cadre des questionnements actuels autour de la fin du travail et à la polémique qu'ils engendrent, il appert que les réticences à vouloir la fin du travail ne manifestent pas seulement le refus d'abandonner les valeurs bourgeoises de l'utilité et de la liberté rattachées au travail (une forme de nostalgie du libéralisme) ; elles manifestent aussi et surtout une confusion conceptuelle issue de son organisation qui, par exemple, fait prendre la managérialisation du travail pour une forme de démocratisation et l'employabilité pour un moyen de redonner sa dignité à l'être humain ( qu'il aurait perdue en même temps que le travail). Cette confusion provient de l'« oubli de la société », du fait que l'on omet de situer le travail dans la totalité sociétale concrète qui l'a fait naître, créature et créatrice des rapports sociaux qui l'ont transformé. Parce que le rôle du management comme agent de cette transformation est habituellement limité par la sociologie du travail à l'expropriation des travailleurs de leur capacité intellectuelle de conception de l'activité de travail, leur participation à la gestion aujourd'hui promue apparaît comme un renversement de situation qui redonne aux travailleurs leur capacité perdue. Or, le management a contribué à transformer de façon irréversible le sens du travail parce qu'il a contribué à transformer radicalement la société. Nous ne pouvons, en sociologie, faire abstraction de cette transformation sociétale et prétendre qu'il suffise de changer l'entreprise et l'activité concrète pour que le travail retrouve ses lettres de « noblesse », bourgeoises et ouvrières.
À l'heure actuelle, l'enjeu crucial est la sauvegarde et la création de pratiques sociales, d'une capacité d'action collective menacée par l'organisation. Tout comme les bourgeois ont imposé leur définition de la liberté contre la servitude féodale, puis les ouvriers, la leur contre la servitude capitaliste, nous avons collectivement la responsabilité de sauvegarder notre aptitude à la liberté contre la servitude gestionnaire. L'exercice de la liberté et la construction d'institutions nouvelles comme espace commun passent par renonciation de questions posant pourquoi et au nom de quoi nous agissons, de « penser ce que nous faisons », comme nous y exhorte Arendt. Ce questionnement est essentiel pour poser un regard critique sur le sort que nous faisons à la société par notre (in) action. Il s'agit en somme de revenir dans la sphère publique, de la recréer, afin de sortir de cet espace privé (atomisé) où nous confine notre condition de travailleur (avec ou sans travail), qui empêche l'expression libre, subjective, intersubjective, imprévisible, l'expression qui s'oppose à la logique organisationnelle de la société. Ce combat ne met pas des adversaires en présence, il n'est pas dirigé contre quelqu'un ou quelque chose : il s’impose pour nous, pour la société.
[1] La révolution du travail, de l’artisan au manager, Rolande Pinard, Liber Montréal, 2008, p. 413-415.
Ce déclin de l'usage des outils semble présager un changement de notre relation avec le monde matériel, débouchant sur une attitude plus passive et plus dépendante. Et de fait, nous avons de moins en moins d'occasions de vivre ces moments de ferveur créative où nous nous saisissons des objets matériels et les faisons nôtres, qu'il s'agisse de les fabriquer ou de le réparer. Ce que les gens ordinaires fabriquaient hier, aujourd'hui, ils l'achètent ; et ce qu'ils réparaient eux-mêmes, ils le remplacent intégralement, ou bien louent les services d'un expert pour le remettre en état, opération qui implique souvent le remplacement intégral d'un appareil en raison du dysfonctionnement d'une toute petite pièce.
Cet ouvrage plaide pour un idéal qui s'enracine dans la nuit des temps mais ne trouve plus guère d'écho aujourd'hui : le savoir-faire manuel et le rapport qu'il crée avec le monde matériel et les objets de l'art. Ce type de savoir-faire est désormais rarement convoqué dans nos activités quotidiennes de travailleurs et de consommateurs, et quiconque se risquerait à suggérer qu'il vaut la peine d'être cultivé se verrait probablement confronté aux sarcasmes du plus endurci des réalistes : l'économiste professionnel. Ce dernier ne manquera pas, en effet, de souligner les « coûts d'opportunité » de perdre son temps à fabriquer ce qui peut être acheté dans le commerce. Pour sa part, l'enseignant réaliste vous expliquera qu'il est irresponsable de préparer les jeunes aux professions artisanales et manuelles, qui incarnent désormais un stade révolu de l'activité économique. On peut toutefois se demander si ces considérations sont aussi réalistes qu'elles le prétendent, et si elles ne sont pas au contraire le produit d'une certaine forme d'irréalisme qui oriente systématiquement les jeunes vers les métiers les plus fantomatiques.
Aux environs de 1985, on a commencé à voir apparaître dans les revues spécialisés en éducation des articles intitulés « La révolution technologique en marche » ou « Préparez vos enfants à un avenir high-tech mondialisé ». Bien entendu, ce genre de futurisme n'est pas nouveau en Amérique. Ce qui est nouveau, c'est le mariage du futurisme et de ce qu'on pourrait appeler le « virtualisme », l'idée que, à partir d'un certain moment, nous finirons par prendre congé de la réalité matérielle et par flotter librement dans un univers économique d'information pure. En fait, ce n'est pas si nouveau, cela fait bien cinquante ans qu'on nous ressasse que nous sommes au seuil de la « société postindustrielle ». S'il est vrai que nombre d'emplois industriels ont migré sous d'autres cieux, les métiers manuels de type artisanal sont toujours là. Si vous avez besoin de faire construire une terrasse ou de faire réparer votre véhicule, les Chinois ne vous seront pas d'une grande utilité. Rien d'étonnant à cela, ils habitent en Chine. Et de fait, on constate l'existence d'une pénurie de main-d'œuvre tant dans le secteur de la construction que dans celui de la mécanique auto. Pourtant, les intellectuels ont trop souvent eu tendance à mettre ces métiers manuels dans le même sac que les autres formes de travail industriel : tout ça, c'est des boulots de « cols bleus », et donc tous censés appartenir à une espèce en voie de disparition. Mais depuis peu, ce consensus a commencé à se fissurer ; ainsi, en 2006, le Wall Street Journal se demandait si « le travail [manuel] qualifié n'était pas en train de devenir l'une des voies privilégiées pour accéder à une vie confortable ».
Ce livre n'est pas vraiment un livre d'économie ; il s'intéresse plutôt à l'expérience de ceux qui s'emploient à fabriquer ou réparer des objets. Je cherche aussi à comprendre ce qui est en jeu quand ce type d'expérience tend à disparaître de l'horizon de nos vies. Quelles en sont les conséquences du point de vue de la pleine réalisation de l'être humain ? L'usage des outils est-il une exigence permanente de notre nature ? Plaider en faveur d'un renouveau du savoir-faire manuel va certainement à rencontre de nombre de clichés concernant le travail et la consommation ; il s'agit donc aussi d'une critique culturelle. Quelles sont donc les origines, et donc la validité, des présupposés qui nous amènent à considérer comme inévitable, voire désirable, notre croissant éloignement de toute activité manuelle ?
(…)
Au moment où j’écris ces lignes[2], l’ampleur de la crise économique est encore incertaine, mais elle semble s’approfondir. Les institutions et les professions les plus prestigieuses sont en train de traverser une véritable crise de confiance. Mais cette crise est aussi une occasion de remettre en question nos présupposés les plus élémentaires. Qu’est-ce qu’un « bon » travail, qu’est-ce qu’un travail susceptible de nous apporter tout à la fois sécurité et dignité ? Voilà une question qui n’avait pas été aussi pertinente depuis longtemps.
Si puissante que soit notre technologie et si complexes que soient nos corporations, la plus remarquable caractéristique du monde contemporain du travail est peut-être finalement interne, consistant en un certain aspect de nos mentalités : la croyance très répandue que notre travail doit nous rendre heureux. Le travail a été au centre de toutes les sociétés ; la nôtre est la première à suggérer qu'il pourrait être beaucoup plus qu'une punition ou une pénitence, et que nous devons chercher à travailler même en l'absence d'un impératif financier. Notre choix d'une profession est censé définir notre identité, au point que la question la plus insistante que nous posons aux gens dont nous faisons la connaissance ne porte pas sur leur origine ou leurs parents, mais sur ce qu'ils font, l'idée étant que le chemin vers une existence dotée de sens doit invariablement passer par le portail d'un emploi satisfaisant et profitable.
Le christianisme ajouta à la conception aristotélicienne la doctrine, plus sombre encore, selon laquelle les misères du travail sont un moyen approprié et immuable d'expier les péchés d'Adam. Ce ne fut pas avant la Renaissance que de nouveaux sons de cloche commencèrent à se faire entendre. Dans les biographies de grands artistes tels que Léonard de Vinci et Michel-Ange, on voit les premières références aux mérites et beautés de l'activité pratique. Si cette réévaluation fut d'abord limitée au travail artistique, et seulement à ses exemples les plus admirés et encensés, elle en vint à englober presque toutes les occupations. Vers le milieu du XVIIIe siècle, en un défi direct à la position aristotélicienne, Diderot et d'Alembert publièrent leur Encyclopédie en vingt-sept volumes, emplie d'articles célébrant le génie particulier que supposent des tâches telles que fabriquer du pain, planter des asperges, faire marcher un moulin à vent, forger une ancre, imprimer un livre ou exploiter une mine d'argent. Le texte était accompagné de planches montrant les outils employés pour effectuer ces tâches — poulies, tenailles, crampons, instruments dont le lecteur ne comprenait peut-être pas toujours l'usage précis, mais dans lesquels il pouvait néanmoins reconnaître des moyens d'accomplir habilement un honnête et digne labeur. Après avoir passé un mois dans une fabrique d'épingles à Laigle en Normandie, le littérateur Alexandre Deleyre rédigea ce qui était peut-être l'article le plus frappant de l’Encyclopédie, dans lequel il décrivait respectueusement les quinze étapes nécessaires pour transformer une pièce de métal en un de ces objets minuscules, souvent peu remarqués, utilisés par les couturières.
Censée être un dictionnaire raisonné des connaissances humaines, l’Encyclopédie était en réalité un hymne à la noblesse du travail. Diderot dévoila ses intentions dans un article sur l'Art où il critiquait sévèrement ceux qui étaient enclins à ne vénérer que les arts « libéraux » (la musique et la philosophie d'Aristote) tout en dédaignant leurs équivalents « mécaniques » (tels que la fabrication d'horloges et le tissage de la soie) : « Les Arts libéraux se sont assez chantés eux-mêmes ; ils pourraient employer maintenant ce qu'ils ont de voix à célébrer les Arts mécaniques. C'est aux Arts libéraux à tirer les Arts mécaniques de l'avilissement où le préjugé les a tenus si longtemps. »
Ainsi les penseurs bourgeois du XVIIIe siècle renversèrent-ils la formule d'Aristote : les satisfactions que le philosophe grec avaient associées au loisir étaient transposées dans la sphère du travail, tandis que les tâches sans récompense financière étaient dépouillées de toute importance réelle et laissées aux attentions fortuites de dilettantes décadents. Il semblait maintenant aussi impossible qu'on pût être heureux et improductif qu'il avait jadis paru improbable qu'on pût travailler et être humain.
Certains aspects de cette évolution dans les attitudes envers le travail avait d'intéressantes corrélations dans les idées sur l'amour. Dans ce domaine aussi, la bourgeoisie du XVIIIe siècle joignait l'agréable au nécessaire. Elle estimait qu'il n'y avait pas d'incompatibilité foncière entre la passion sexuelle et les exigences pratiques de la paternité ou maternité dans une cellule familiale, et qu'il pouvait donc y avoir de l'amour dans le mariage — comme il pouvait y avoir du plaisir dans un emploi rémunéré.
Engageant un processus dont nous sommes encore les héritiers, la bourgeoisie européenne fit le grand pas d'admettre à la fois dans le mariage et dans le travail les satisfactions que les aristocrates avaient limitées jusque-là d'une façon pessimiste — ou peut-être réaliste — aux domaines subsidiaires de la liaison amoureuse et du passe-temps.
Je ne suis revenue chez moi que deux fois, en coup de vent : j'avais trop à faire là-bas. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, et je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde.
Je n'ai plus quitté mes lunettes. Je n'ai touché aucune allocation.
Il était convenu que je m'arrêterais le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre raconte ma quête, qui a duré presque six mois, de février à juillet 2009. J'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée cet hiver écrire ce livre. »
[1] Le quai de Ouistreham, Florence Aubenas, Éditions de l’Olivier, 2010, quatrième de couverture.
On ne peut défendre l'automatisation sans assumer les problèmes sociaux qu'elle crée et l'irrationalité économique qu'elle induit dans l'état actuel de nos économies. Il n'y a donc pas d'autre solution que de produire une nouvelle rationalité économique, une rationalité de l'automatisation. Je ne dis pas qu'il faut empêcher l'automatisation de se développer, tout au contraire, je crois, comme les ministres de l'Économie qui se succèdent en France, qu'il faut s'y engager résolument – d'autant qu'elle va se développer avec ou sans les gouvernements, que ceux-ci cherchent à en freiner ou à en accélérer l'avancée, à plus ou moins long terme. L'enjeu est donc de penser et d'expérimenter de nouveaux modèles intégrant de façon rationnelle cette vérité de l'automatisation. Et pour cela, il y a des hypothèses.
La mienne, qui n'est pas seulement la mienne, puisque c'est celle de l'association Ars Industrialis, c'est qu'il faut prendre le régime des intermittents du spectacle pour modèle. Celui-ci constitue la matrice du revenu contributif en matière de droit du travail, comme le logiciel libre est notre matrice de référence en matière de droit de la propriété intellectuelle et de l'organisation du travail.
Il faut cesser de définir les allocations de ressources par rapport à l'emploi, que ce soit pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont en cela dits chômeurs, ou pour ceux qui sont employés, c'est-à-dire salariés. Admettons qu'il n'y ait plus structurellement ni chômage ni salariat, sinon à la marge du système macro-économique. Il faut dès lors inventer une autre façon d'allouer des ressources, qui soit, d'une part, favorable à la solvabilité du système nouveau fondé sur l'automatisation, qui permette l'existence de marchés sur lesquels vendre les marchandises produites par les robots aussi bien que par les postes de production temporairement salariés (comme c'est le cas dans le régime d'intermittence) et, d'autre part, productrice de capacitation et en cela d'une valeur d'un nouveau genre, au-delà des valeurs d'usage et d'échange, néguentropique donc, que nous appelons la valeur pratique, et qui est caractéristique de ce qui constitue les savoirs sous toutes leurs formes – savoirs dont chacun s'accorde à reconnaître qu'ils constitueront la plus haute des valeurs dans la société qui vient. La valeur pratique ne s'use pas, ne se jette pas, est irréductible à sa valeur d'échange (à la différence de la valeur d'usage ou de la force de travail) et permet de valoriser le passé tout en se projetant dans l'avenir. C'est cette valeur, le savoir, qu'une nouvelle façon de redistribuer ce qui est gagné avec l'automatisation, à savoir du temps, doit engendrer à travers une théorie et une pratique économiques qui dépassent les notions anciennes de valeur d'échange et de valeur d'usage. Anciennes, je le précise, ne veut pas dire ici caduques, mais insuffisantes face aux défis de l'automatisation généralisée.
Le revenu minimum d'existence ne suffit pas, même si nous en soutenons le principe. Il faut créer un revenu contributif qui permette aux gens de produire des externalités positives fondées sur de la valeur pratique, et engendrant en outre de la valeur sociétale. La valeur sociétale est structurellement et fonctionnellement génératrice de solidarité. Il s'agit d'une solidarité fonctionnelle, qui n'est pas fondée simplement sur le cœur, mais sur la raison et l'efficacité – c'est-à-dire aussi sur le partage que produit la valeur pratique en tant qu'elle consiste dans le développement, la circulation et la transmission des savoirs. La valeur pratique est partagée parce qu'elle constitue du savoir, et tout savoir est ce qui fait l'objet de transmissions et d'échanges avec d'autres « sachants » aussi bien que vers ceux qui ne savent pas encore et qu'il s'agit d'éduquer ou d'instruire. Les savoirs créent spontanément des communautés qui perdurent à travers les générations parce qu'ils constituent l'accumulation de l'expérience humaine, laquelle est son patrimoine commun, et le plus précieux qui soit, mais qui ne doit pas être approprié et privatisé comme c'est aujourd'hui le cas.
À l'inverse de la valeur pratique, la valeur d'usage se perd avec le temps et se dilue de façon inflationniste dans la valeur d'échange. Vous achetez des chaussures, vous les portez, elles se dévalorisent. Soit elles ne sont plus à la mode si vous êtes un consommateur parfait de votre époque, soit tout simplement les semelles s'abîment et vous êtes obligé de les jeter, un jour ou l'autre, même si vous pouvez d'abord les confier au cordonnier pour autant qu'elles sont réparables. De toute façon, cela s'use. La valeur pratique, en revanche, se développe et s'enrichit avec le temps en constituant du savoir. Or, la société de demain sera nécessairement une société de savoir s'il est vrai que, face aux incroyables défis auxquels l'humanité est désormais confrontée, une augmentation et un partage sans précédent des savoirs et de l'intelligence collective sont tout simplement les conditions sine qua non de sa survie.
Certains comme Tony Blair parlent de la société de la connaissance, entendant par-là les industries de la connaissance, mais cette société de la connaissance n'est en réalité et pour le moment qu'une société de l'automatisation (et une « dissociété », comme dit Jacques Généreux). Elle ne donnera une société du savoir qu'à la condition de transformer très en profondeur les organisations sociales de la société industrielle intégralement automatisée.
La question est d'inventer une nouvelle façon de produire de la valeur par la redistribution intelligente des gains de productivité. L'automatisation génère des gains de productivité qui ne sont plus redistribuables sous forme de salaire, puisque cette productivité nouvelle consiste à remplacer l'emploi salarié par le robot. Or, on ne va pas donner un salaire au robot : le robot ne consomme pas plus que l'énergie dont il a besoin. C'est donc aux individus privés d'emploi par les robots qu'il faut donner un salaire. Mais puisqu'il n'y a plus ni emploi ni chômage, ce ne sera ni un salaire ni une allocation de chômage : ce sera un revenu contributif. Ce revenu contributif, c'est un revenu alloué à tout le monde sur une base qui permet de vivre décemment, de s'éduquer et de développer des capacités, c'est-à-dire des formes de savoir, que la société a besoin de valoriser et qui est un droit « rechargeable » en fonction de l'activité de socialisation de capacités ainsi développées par les individus en direction des groupes. Le 21 mars 2015, Arnauld de L'Épine a présenté au théâtre Gérard Philipe un train de mesures que nous recommandons de mettre en œuvre sans tarder sur les territoires d'expérimentation, proposant notamment des dispositifs d'évaluation de la valeur contributive, de définition collective de projets contributifs et d'investissements contributifs, et des principes de financement d'une nouvelle puissance publique contributive. Tour cela nous paraît être la condition de concrétisation d'une politique systématique de capacitation au sens d'Amartya Sen et à l'époque des technologies réticulaires numériques.
Amartya Sen est un économiste qui a montré que les sociétés qui maintiennent leur savoir-vivre sont beaucoup plus résistantes que les autres. Il a mené des recherches sur les Bangladais, essayant de comprendre pourquoi et comment leur espérance de vie est supérieure à celle des habitants de Harlem alors qu'ils n'ont pas accès à l'eau courante, pas d'égouts, pas d'écoles... Sen a montré qu'ils sont « résilients » parce qu'ils ont réussi à maintenir et développer leur savoir-vivre, formé par ce qu'il appelle des capacités.
Que le monde de demain ne puisse trouver sa voie que dans une nouvelle forme de société industrielle où le savoir va être amené à se développer comme jamais, et sans doute sous des formes inédites, c'est absolument évident. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a annoncé le 13 avril 2014 qu'il va probablement y avoir une montée de la température de 4,8 degrés centigrades dans le monde d'ici la fin du siècle si rien ne change. Si on ne met pas l'automatisation au service d'une renaissance des savoirs, la catastrophe est inéluctable.
La société planétaire est confrontée à d'immenses problèmes : réchauffement climatique, démographie, crise de l'eau, pathologies mentales en tout genre, etc. – et insolvabilité structurelle que masque la « cavalerie » assistée par ordinateur en quoi consiste de nos jours la spéculation. Face au nombre de défis auxquels l'humanité est confrontée, les travaux d'Hercule sont une partie de campagne. Pour résoudre ces immenses problèmes, il n'y a pas d'autre possibilité que d'élever l'intelligence collective en augmentant spectaculairement les savoirs partagés – ce que précisément l'automatisation rend possible sans doute pour la première fois.
Cela signifie qu'il faut remplacer le pouvoir d'achat par du savoir d'achat. Je dis « savoir d'achat » parce que, dans le modèle auquel nous réfléchissons à Ars Industrialis, il continue à y avoir de l'achat, c'est-à-dire de la valeur d'échange – même si ce n'est plus la base de la société. Mais cet achat – de billets de train, d'ordinateurs, de boîtes de petits pois – n'est plus organisé par un pouvoir d'achat, ni par une incitation à l'achat mise en œuvre par le marketing et la publicité qui prescrivent des comportements d'achat irresponsable. Il faut remplacer cela par le savoir d'achat, c'est-à-dire par une économie marchande intelligente. Intelligente veut dire ici soutenable, rationnelle, qui valorise ce qui peut l'être, en étant le plus économe possible, parce que cela fait beaucoup de monde, les 9 milliards d'habitants attendus sur la planète avec une élévation très sensible de la température... Et donc il est très important que ces habitants aient une pensée collective de la rationalité au sein de laquelle seulement ils peuvent vouloir et savoir vivre ensemble, et non s'entre-tuer dans un massacre généralisé.
C'est absolument réalisable. Et c'est réalisable dans une période qui commence maintenant, et qui, dans vingt ans, si l'on croit Bill Gates aussi bien que Randall Collins et tous ceux que j'ai déjà cités, aboutira à la disparition définitive de la société fondée sur l'emploi. La tendance est évidemment là, tous les gens un peu sérieux le reconnaissent, et ceux qui disent le contraire soit sont ignorants et incompétents, soit se mettent la tête dans le sable, soit sont malhonnêtes. Après cela, il y a évidemment bien des façons de voir les vingt années à venir et le temps de cette économie de transition dans laquelle nous devons nous engager.
[1] L’emploi est mort, vive le travail ! Entretien de Bernard Stiegler avec Ariel Kyrou, Éditions Mille et une nuits, mai 2015, p. 101-111
- L’emploi est mort, vive le travail ! Entretien de Bernard Stiegler avec Ariel Kyrou, Éditions Mille et une nuits, mai 2015.
- Le quai de Ouistreham, Florence Aubenas, Éditions de l’Olivier, 2010.
- Splendeurs et misères du travail, Alain de Botton, Mercure de France, 2010.
- Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail, Matthew B. Crawford, La Découverte, 2010.
- Réinventer la politique avec Hannah Arendt, Thierry Ternisien d’Ouville, Éditions Utopia, 2010.
- La révolution du travail, de l’artisan au manager, Rolande Pinard, Liber Montréal, 2008.
- Le travail sans l’homme ? Pour une psychologie des milieux de travail et de vie, Yves Clot, La Découverte, 1995-2008.
- Travail et intégration sociale, Bruno Flacher, Bréal, 2008.
- Les désordres du travail, enquête sur le nouveau productivisme, Philippe Askenazy, La République des Idées, Éditions du Seuil, 2004.
- Le travail sans qualités, Richard Sennet, 10/18, Albin Michel, 2000.
- Le travail, une valeur en voie de disparition, Dominique Méda, Champs/Flammarion, 1995.
- Métamorphoses du travail, critique de la raison économique, André Gorz, foliosessais n°441, Éditions Galilée, 1988.
- Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt, Agora/Pocket, 1958 pour la publication originale et 1961 pour la traduction française.