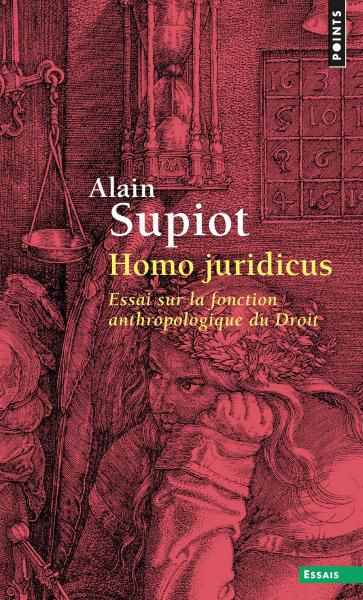Homo juridicus (EPMN 2/4)
Cours donné dans le cadre de l'association AHA les 9 et 16 janvier 2020.
L'homme est un animal métaphysique. Être biologique, il est d'abord au monde par ses organes des sens. Cependant sa vie se déploie non seulement dans l'univers des choses, mais aussi dans un univers de signes. Cet univers s'étend, au-delà du langage, à tout ce qui matérialise une idée et rend ainsi présent à l'esprit ce qui est physiquement absent. C'est le cas de toutes les choses dans lesquelles est inscrit un sens et notamment des objets fabriqués qui, des plus humbles (une pierre taillée, un mouchoir) aux plus sacrés (La Joconde, le Panthéon), incorporent l'idée qui a présidé à leur fabrication et se distinguent ainsi du monde des choses naturelles. C'est aussi le cas des marques (normes vestimentaires, maquillage, tatouages, etc.) ou des disciplines (gestes, rituels, danses, etc.) qui font du corps humain lui-même un signe. La vie des sens se mêle dans l'être humain à un sens de la vie, auquel il est capable de se sacrifier, donnant ainsi à sa mort elle-même un sens. Attacher une signification à soi-même et au monde est vital pour ne pas sombrer dans le non-sens, c'est-à-dire pour devenir et rester un être de raison humaine.
Tout être humain vient ainsi au monde avec une créance de sens, du sens d'un monde déjà là, qui confère une signification à son existence. Cet accès au sens suppose que chaque enfant apprenne à parler et se soumette donc au « Législateur de la langue ». Si ce législateur est bien, comme l’écrit Platon, « celui qui le plus rarement apparaît dans l'humanité », c'est parce qu'il se cache ordinairement derrière le visage de notre mère. La langue maternelle, première source du sens, est aussi la première des ressources dogmatiques indispensables à la constitution du sujet. La liberté qu'elle donne à chacun de penser et de s'exprimer comme il veut suppose que tous se soumettent aux limites qui donnent sens aux mots qu'elle contient ; sans sa radicale hétéronomie, il n'y aurait pas d'autonomie possible. Mais, avant même d'accéder ainsi par la parole à la conscience de son être, tout nouveau-né aura été nommé, inscrit dans une filiation : une place lui aura été attribuée dans une chaîne générationnelle. Car c'est avant même que nous ayons pu dire « je » que la loi a fait de chacun de nous un sujet de droit. Pour être libre, le sujet doit d'abord être lié (sub-jectum : jeté dessous) par des paroles qui l'attachent aux autres hommes. Les liens du Droit et les liens de la parole se mêlent ainsi pour faire accéder chaque nouveau-né à l'humanité, c'est-à-dire pour attribuer à sa vie une signification, dans le double sens, général et juridique, de ce mot. Coupé de tout lien avec ses semblables, l'être humain est voué à l'idiotie, au sens étymologique du terme (grec idios : « qui est restreint à soi-même »). Est pareillement menacé d'idiotie celui qui, enfermé dans sa propre vision du monde, est incapable de comprendre qu'il en est d'autres possibles, c'est-à-dire incapable de s'accorder avec ses semblables sur une représentation du monde où chacun ait sa juste place. L'aspiration à la Justice n'est donc pas le vestige d'une pensée préscientifique, mais représente, pour le meilleur et pour le pire, une donnée anthropologique fondamentale. L'homme peut tuer et mourir pour une cause qu'il estime juste (sa Liberté, sa Patrie, son Dieu, son Honneur, etc.) et de ce point de vue il y a en chacun de nous une bombe.
L'homme ne naît pas rationnel, il le devient en accédant à un sens partagé avec les autres hommes. Chaque société humaine est ainsi à sa manière l'instituteur de la raison. La texture de ce que nous appelons « société » est faite de liens de parole, qui attachent des hommes les uns aux autres, et il n'y a donc pas de ce point de vue de société animale possible. En français courant, on parle de loi et de contrat pour distinguer les deux sortes de liens de Droit qui nous tiennent et nous font tenir ensemble : du côté de la loi se trouvent les textes et les paroles qui s'imposent à nous indépendamment de notre volonté, et du côté du contrat ceux qui procèdent d'un libre accord avec autrui. Toute personne se trouve d'abord tenue par l'état civil que la loi lui attribue avant de l’être par les engagements qu'elle contracte. Toutes nos paroles ne nous lient pas, ne nous « obligent » pas, au sens à la fois littéral et étymologique du mot obligation (ob-ligare : « attacher à ») ; je ne suis par exemple nullement tenu par ce que je suis en train d'écrire en ce moment et conserve le droit de m'en dédire ou de me contredire. Et, parmi les paroles et les textes qui m'obligent, qui m'attachent à autrui, il faut distinguer ceux qui procèdent de moi et ceux qui procèdent d'autrui. Car les paroles qui ont autorité sur moi, sans que je les ai prononcées ou acceptées, ont été nécessairement premières dans le cours de ma vie. Nos notions de loi et de contrat sont ainsi étroitement liées entre elles et procèdent toutes deux de la croyance en un Législateur divin également garant de la parole donnée par ceux qui croient en lui, qui lui sont fidèles et sont donc aussi fidèles à leur parole. C'est pourquoi on ne les retrouve pas sous cette forme générale et abstraite dans d'autres civilisations, par exemple en Chine ou au Japon. Communes aux civilisations du Livre, les idées de Loi et de contrat représentent seulement une façon parmi d'autres d'instituer la justice parmi les hommes, et de les soumettre à l'empire de la raison.
Faire de chacun de nous un «homo juridicus » est la manière occidentale de lier les dimensions biologique et symbolique constitutives de l'être humain. Le Droit relie l'infinitude de notre univers mental à la finitude de notre expérience physique et c'est en cela qu'il remplit chez nous une fonction anthropologique d'institution de la raison. La folie guette dès que l'on nie l'une ou l'autre des deux dimensions de l'être humain, soit pour le traiter comme un animal soit pour le traiter comme un pur esprit, affranchi de toute limite hors celles qu'il se donne à lui-même. Pascal avait trouvé pour le dire les mots les plus simples : l'Homme n'est ni ange ni bête. Mais cette idée simple nous demeure difficile à comprendre, car nos catégories de pensée opposent le corps et l'esprit, le « matérialisme » et le « spiritualisme ». Attisées par les progrès des sciences et des techniques, ces dichotomies nous portent à croire d'une part que l'Homme pourra être expliqué comme n'importe quel objet naturel, qu'il n'y a rien à savoir sur lui que les sciences de la nature ne puissent un jour nous dévoiler et nous permettre de manipuler ; et, d'autre part, que l'Homme ainsi devenu transparent à lui-même pourrait s'affranchir un jour de toute détermination naturelle : choisir son sexe, ne plus être atteint par l’âge, vaincre la maladie et, pourquoi pas, la mort elle-même. Regarder l'homme comme un pur objet ou le regarder comme un pur esprit sont les deux faces d'un même délire.
L'une des leçons que Hannah Arendt a tirée de l'expérience du totalitarisme est que « le premier pas essentiel sur la route qui mène à la domination totale consiste à tuer en l'Homme la personne juridique ». Nier la fonction anthropologique du Droit au nom d'un prétendu réalisme biologique, politique ou économique est un point commun de toutes les entreprises totalitaires. Cette leçon semble aujourd'hui oubliée par les juristes qui soutiennent que la personne juridique est un pur artefact sans rapport avec l'être humain concret. Artefact, la personne juridique l'est, à n'en pas douter. Mais, dans l'univers symbolique qui est le propre de l'homme, tout est artefact. La personnalité juridique n'est certes pas un fait de nature ; c'est une certaine représentation de l'homme, qui postule l'unité de sa chair et de son esprit et qui interdit de le réduire à son être biologique ou à son être mental. C'est pourquoi on a éprouvé le besoin, au sortir de l'horreur nazie, de garantir la personnalité juridique à tout homme et en tout lieu. C'est cet interdit qui est en fait visé par ceux qui cherchent aujourd'hui à disqualifier le sujet de droit pour pouvoir appréhender l'être humain comme une simple unité de compte, et le traiter comme du bétail ou, ce qui revient au même, comme une pure abstraction.
Cette réduction de l'homme va de pair avec la dynamique du calcul, qui a porté le capitalisme et la science moderne. C'est sur ce mode que tend par exemple à être interprété aujourd'hui le principe juridique d'égalité. L’égalité algébrique autorise l'indifférenciation : si je dis <a = b>, il s'en déduit que partout où se trouve a, je pourrai poser indifféremment b, et que donc <a+b = a+a = b+b>. Appliqué à l'égalité entre les sexes, cela voudrait dire qu'un homme est une femme et réciproquement. Or l'égalité entre hommes et femmes ne signifie pas que les hommes soient des femmes, même s'ils peuvent en rêver parfois. Le principe d'égalité entre hommes et femmes est l'une des conquêtes les plus précieuses et les plus fragiles de l'Occident. Il ne pourra prendre durablement racine si cette égalité est entendue sur le mode mathématique, c'est-à-dire si l'on traite l’être humain sur un mode purement quantitatif. Toute la difficulté des sociétés modernes est justement de devoir penser et vivre l'égalité sans nier les différences. Cela doit s'entendre des relations aussi bien entre hommes et femmes qu'entre des hommes ou des femmes de nationalités, de mœurs, de cultures, de religions ou de générations différentes. La marque propre du capitalisme n'est pas la poursuite de la richesse matérielle, mais l'empire de la quantité qu'il fait régner sur la diversité des hommes et des choses. L’égalité fait l'objet d'interprétations folles lorsque, sous l'empire de la quantité, nous sommes conduits à croire en l'abstraction du nombre indépendamment de la qualité des êtres dénombrés.
Calculer n'est pas penser, et la rationalisation par le calcul qui a porté le capitalisme devient délirante lorsqu'elle conduit à tenir l'incalculable pour rien. La capacité de calcul est à l'évidence un attribut essentiel de la raison, mais elle n'est pas le tout de la raison. C'est la formalisation logique de cette capacité de l'esprit qui a permis l'invention de l'ordinateur. La démarche consistant à projeter ainsi l'esprit humain dans un objet matériel a toujours été, depuis le premier silex taillé, le ressort du progrès technique et de la maîtrise humaine des choses. Mais c'est d'un mouvement inverse que procède aujourd'hui le « cognitivisme » qui nous tient lieu de science de l'esprit : il projette sur l'esprit humain le modèle de la machine à calculer et espère ainsi, les nanotechnologies aidant, parvenir un jour à la maîtrise matérielle de la pensée. Il repose, comme l'idéologie économique en vigueur, sur la croyance que l'être rationnel est un pur être de calcul, et que son comportement peut donc être lui-même calculé et programmé. Mais, pour calculer, il faut pouvoir oublier la diversité des choses et des êtres et ne retenir d'eux que cette caractéristique élémentaire qu'est leur cardinal. Cet oubli, oubli nécessaire au calcul d'intérêt comme au calcul scientifique, est rendu possible par l'existence de cet autre versant de la raison humaine qui prend en charge tout ce qui résiste à l'abstraction du nombre. Il n'y a pas de mathématique sans postulats indémontrables, sans axiomes sur lesquels l'esprit puisse se fonder. On n'additionne pas des limaces et des nuages, car on ne peut dénombrer que des objets identifiables auxquels on prête une nature commune ; et les catégories de pensée au travers desquelles nous identifions et classons les objets naturels ne sont pas elles-mêmes des êtres mathématiques, ce qui ne veut pas dire que cette identification et ce classement ne soient pas rationnels. Le travail de la pensée consiste à conférer au calcul une signification, en rapportant toujours les quantités mesurées à un sens de la mesure. Et la définition de ce sens a inévitablement une dimension dogmatique, car nos catégories de pensée ne nous sont pas données par la nature ; elles sont un moyen que nous nous donnons pour la comprendre.
Sapere aude ! « Ose te servir de ton propre entendement ! » La fameuse devise de Kant nous rappelle l'acte de foi sur lequel ont reposé les Lumières : la foi en l'homme comme être de raison. La fidélité aux Lumières consiste donc à croire l'homme capable de penser librement. Cet acte de foi n'interdit pas de s'interroger sur les conditions dans lesquelles l'homme peut accéder ainsi à la raison. Mais il interdit en revanche de l'assimiler à l'animal ou à la machine ou de prétendre l'expliquer entièrement par le jeu de déterminations extérieures. Les sciences de l'Homme, lorsqu'elles singent les sciences dures et s'efforcent de réduire l'humain à un objet explicable et programmable, ne sont plus elles-mêmes que des résidus de la dogmatique occidentale, des traces pitoyables d'une pensée scientifique en voie de décomposition, qui s'emploie à faire disparaître les questions qu'elle devrait éclairer. Car c'est en vain qu'elles s'acharnent à faire entrer les sociétés humaines dans des modèles empruntés à la mécanique ou à la biologie. Tandis que l'organisme biologique trouve en lui-même sa propre norme, c'est à l'extérieur de la société humaine que doit être découverte la norme qui la fonde et qui nous assure d'y avoir une place. Il y a là, selon Georges Canguilhem, « l'un des problèmes capitaux de l'existence humaine et l'un des problèmes fondamentaux que se pose la raison ». Cela veut dire que le sens de la vie ne gît pas dans nos organes, mais procède nécessairement d'une Référence qui nous est extérieure. Refuser de le comprendre, identifier la raison à l'explication scientifique ou le Droit à la régulation biologique ne peut qu'ouvrir toutes grandes les vannes de la folie et du meurtre. Car, une fois devenus aveugles à la question de l'institution de la raison, nous sommes amenés à considérer la société comme un amas de particules élémentaires mues par le calcul de leurs utilités individuelles, ou par leur complexion physico-chimique. Tous les êtres humains sont alors sommés de se comporter en êtres autosuffisants, alors qu'aucun d'entre eux ne peut se passer des autres. Faute de Référence commune qui garantisse à chacun un sens et une place, chacun est pris au piège de l'autoréférence et n'a le choix qu'entre la solitude et la violence. L'homme devient alors un loup pour l'homme, et se trouve en proie à ce que Vico nommait la « maladie civile » des peuples en décomposition.
Si la science et la technique, de même que l'économie de marché, sont historiquement les fruits de la civilisation occidentale et lui demeurent étroitement liées, c'est en raison des croyances sur lesquelles cette civilisation s'est fondée. L’entreprise scientifique et technique a procédé de la croyance que Dieu avait donné la Terre en héritage à l'Homme, qu'il avait organisé la Nature selon des lois immuables et que la connaissance de ces lois permettrait à l'Homme de s'en rendre maître. La puissance matérielle de l'Occident doit ainsi beaucoup au christianisme, qui a cimenté son identité. Nous sommes enclins à penser que cela appartient au passé et que les sociétés occidentales se sont émancipées de la religion. Le « désenchantement du monde » et la « sortie du religieux » sont devenus des poncifs, répandus par les sciences sociales, et beaucoup d'Occidentaux voient dans l'attachement d'autres peuples aux fondements religieux de leur société un archaïsme appelé à disparaître. Les choses paraissent différentes si l'on se rappelle que le sens du mot « religion » s'est inversé avec la sécularisation de nos sociétés. Il y a donc religion... et Religion. Jadis fondement dogmatique de la société, la religion est aujourd'hui une affaire de liberté individuelle ; de chose publique, elle est devenue une chose privée, et c'est pourquoi parler de religion est de nos jours une source inépuisable de malentendus. Au Moyen Âge, la Religion n'était pas en Europe une affaire privée, et il n'y avait donc pas de religion au sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot. La Religion médiévale fondait à la fois la situation juridique du Prince et celle de ses sujets. Même le Droit des marchands, la lex mercatoria qui s'élabore durant cette période, a été le fait de bons chrétiens unis par une foi commune. Le trust – qui allait devenir un formidable outil du capitalisme – a été inventé pour les besoins des moines franciscains, donataires de biens dont ils ne voulaient pas accepter la propriété. L'idée d'un État qui ne meurt jamais trouve ses origines dans celle de corps mystique, avec la théorie des deux corps du roi. L'Occident moderne a certes sécularisé ces notions, et fait de l'État le garant ultime de l'identité des personnes et de la parole donnée. Mais la distinction est demeurée entre ce qu'à grands traits on pourrait appeler le domaine de la foi et celui du calcul. Le domaine de la foi est celui du qualitatif et de l'indémontrable ; il a été essentiellement l'affaire de la loi et de la délibération publique. Le domaine du calcul, du quantitatif, a été l'affaire du contrat et de la négociation.
Le fait que le christianisme ait perdu aujourd'hui dans certains États occidentaux toute place constitutionnelle ne signifie nullement que ces États se trouvent dépourvus de fondements dogmatiques. Les États comme les personnes continuent d'être portés par des certitudes indémontrables, par de vraies croyances, qui ne procèdent pas d'un libre choix, car elles participent de leur identité. Demander à un Anglais s'il « croit en la Reine » (chef de l'État et de l'Église anglicane : « God save the Queen ! ») ou à un Français s'il « croit en la République » (« indivisible, laïque, démocratique et sociale ») serait aujourd'hui presque aussi saugrenu que l'aurait été dans l'Europe médiévale la question « Croyez-vous au Pape ? ». Certes, la dernière en date des croyances de l'Homme occidental est qu'il ne croit plus en rien. Elle est spécialement répandue dans les vieux pays catholiques, qui sont aussi ceux où l'État a le plus clairement divorcé d'avec l'Église. Mais même ceux qui se disent aujourd'hui incroyants admettront vite qu'ils croient dans la valeur des dollars qu'ils serrent sur leur poitrine, alors qu'il ne s'agit que de simples morceaux de papier. Il est vrai qu'on y lit « in God we trust » et que le président des États-Unis, qui doit prêter serment sur la Bible, ne manque pas une occasion de rappeler le lien spécial qui unit son pays à Dieu, lien qu'exprime aussi sa devise : « God bless America. » Mais un yen ou un euro suscitent une confiance égale à celle du dollar, alors même qu'on a pris soin de les nettoyer de toute référence religieuse.
Au cœur même de la rationalité par le calcul qui marque notre temps se trouvent toujours des croyances instituées et garanties par le Droit. L'économie, dès lors qu'elle fait appel à l'échange, est d'abord une affaire de crédit (étym. credere : « croire ») ; la généralisation du libre-échange la fait reposer tout entière sur des fictions juridiques, telles que la personne morale, ou encore la circulation de créances, c'est-à-dire la circulation des croyances. Ces fondements dogmatiques du marché redeviennent visibles lorsque la foi des opérateurs économiques vient à vaciller. Se mettent-ils à douter de la vérité des images chiffrées qui, au travers des règles de la comptabilité, sont les icônes des entreprises ? Resurgissent alors bien vite la vieille technique du serment et les lourdes peines du parjure, que la loi américaine est en train d’étendre au monde entier, pour restaurer la foi ébranlée dans l'authenticité des images comptables. En fin de compte, aucun État, pas même ceux qui se proclament absolument laïcs, ne saurait se maintenir sans mobiliser un certain nombre de croyances fondatrices, qui échappent à toute démonstration expérimentale et déterminent sa manière d'être et d'agir. De même que la liberté de parole et la possibilité de communiquer n'y seraient pas possibles sans la dogmaticité de la langue, de même les hommes ne pourraient y vivre librement et en bonne intelligence sans la dogmaticité du Droit.
L’entreprise occidentale de domination du reste du monde s'est fondée sur la certitude de détenir la vérité et de surpasser toutes les autres sociétés humaines. Cette certitude demeure chez nous inentamée, même si elle a pris des visages divers au cours de l'histoire. Elle a d'abord été portée par les dogmes du christianisme romain. La notion même d'Occident est sortie de là, par opposition au christianisme de l'empire d'Orient, et ce sont ces dogmes qui ont d'abord servi à justifier l'entreprise de conquête et de conversion du monde non chrétien. La Science a ensuite pris le relais de la religion comme justification de la domination des autres peuples. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une inégalité biologique entre les hommes a fait ainsi partie des « vérités scientifiques » largement propagées par la Science post-darwiniste, surtout en terre protestante. Dans les pays de culture catholique, comme la France, c'est plutôt l'idée d'une mission historique de l'Occident qui a servi à justifier l'entreprise coloniale, « mission civilisatrice » visant à convertir aux Lumières les peuples vivant encore dans l'obscurité et la superstition. L'inégalité des races n'a pas survécu à l'expérience nazie, ni la mission civilisatrice à l'effondrement des empires coloniaux. Mais les lois occidentales de l'histoire demeurent en vigueur, sous une forme légèrement amendée. L'humanité se divise désormais en pays développés et en pays sous-développés, plus récemment dits « en voie de développement » ; des économistes bien intentionnés ont même construit des « indicateurs de développement humain » qui servent à mesurer le retard que certains hommes ont encore à combler par rapport aux Occidentaux. Quant à ceux qui prêchent la fin de l'histoire, ils voient dans l'observation des lois de l'économie par les pays occidentaux la raison objective de leur domination sur le reste du monde. Ce credo est relayé par les organisations internationales et communautaires, qui œuvrent à étendre au monde entier les bienfaits supposés d'une économie dérégulée. Quoi qu'il arrive, les pays occidentaux sont certains d’être dans le sens de l'histoire, sens auquel ils sont du reste les seuls à croire.
Les ordres juridiques occidentaux, qui ont porté le plus loin la conception de l'homme comme être rationnel, reposent eux-mêmes sur des énoncés de facture dogmatique. Ainsi, par exemple, la déclaration qui se trouve en tête du préambule de la Constitution française de 1946, repris par celle de 1958 : « Le Peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. » Le Sujet qui proclame ainsi des « droits sacrés » (le Peuple français) échappe évidemment à notre mortelle condition, ce qui l'autorise à rappeler au monde quelque chose qu'il lui avait déjà dit en 1789. Et ce quelque chose est la sacralité de l'Homme. Pareillement, la Déclaration d'indépendance des États-Unis repose sur ce qu'elle appelle des « vérités évidentes en elles-mêmes » (« We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator by certain inalienable rights... »), c'est-à-dire sur des dogmes au sens étymologique du mot (ce qui est vrai et ce qui est montré et honoré comme tel). Nous sommes bien ici devant un énoncé de facture religieuse, au sens historiquement premier du terme, c'est-à-dire un énoncé qui ne relève pas de la libre appréciation de chacun, mais qui s'impose absolument et intemporellement à tous. Le poncif indéfiniment rabâché du retard du Droit sur les faits ignore cette temporalité propre aux systèmes juridiques. Comme tout système dogmatique, le Droit ne se situe pas dans le continuum du temps chronologique, mais dans un temps séquentiel où la loi nouvelle vient tout à la fois réitérer un Discours fondateur et engendrer de nouvelles catégories cognitives.
C'est à Pierre Legendre que l'on doit d'avoir remis ce concept de dogmatique au cœur de l'analyse de la modernité. Concept clé de l'histoire des sciences (notamment de la médecine), la dogmatique est aujourd'hui perçue dans le vocabulaire courant comme l'antithèse de la raison. Et pourtant, la raison humaine repose, aujourd'hui comme hier et en Occident comme ailleurs, sur des fondements dogmatiques, c'est-à-dire sur l'existence d'un « lieu de la vérité légale, postulé et socialement mis en scène comme tel ». L'accès à la parole, qui est le propre de l'humanité, est aussi une porte ouverte à tous les délires. La dogmatique est là pour fermer cette porte. Cette dimension dogmatique de la raison humaine n'échappait pas aux pères fondateurs des sciences de l'Homme. Selon Tocqueville, « les croyances dogmatiques peuvent changer de forme et d'objet ; mais on ne saurait faire qu'il n'y ait pas de croyances dogmatiques, c'est-à-dire d'opinion que les hommes reçoivent de confiance et sans les discuter ». Auguste Comte, qui s'employa à fonder d'un même pas le positivisme scientifique et la Religion de l'Humanité, est encore plus explicite : « Le dogmatisme est l'état normal de l'intelligence humaine, celui vers lequel elle tend, par sa nature, continuellement et dans tous les genres, même quand elle semble s'en éloigner le plus. Car le scepticisme n'est qu'un état de crise, résultat inévitable de l'interrègne intellectuel qui survient nécessairement toutes les fois que l'esprit humain est appelé à changer de doctrines, et en même temps moyen indispensable employé soit par l'individu, soit par l'espèce, pour permettre la transition d'un dogmatisme à un autre, ce qui constitue la seule utilité fondamentale du doute [...]. Les peuples modernes ont obéi à cette impérieuse loi de notre nature, jusque dans leur période révolutionnaire puisque toutes les fois qu'il a fallu réellement agir, même seulement pour détruire, ils ont été conduits inévitablement à donner une forme dogmatique à des idées purement critiques par leur essence. » Et l'on sait la place centrale que le fait religieux occupe dans la sociologie de Durkheim ou celle de Weber, comme dans l'anthropologie de Marcel Mauss ou de Louis Dumont, aucun de ces grands auteurs n'ayant jamais perdu de vue les croyances qui soudent les sociétés humaines. Mais l'idée de dogmatique apparaît aujourd'hui comme l'envers de la raison, comme quelque chose d'obscène dont il faudrait se purger.
Comme le Droit est le dernier lieu où la dogmatique est encore explicitement à l'œuvre, on s'efforce de le dissoudre dans les lois de la Science : hier les lois de l'histoire ou les lois de la race, aujourd'hui les lois de l'économie ou de la génétique. Cette entreprise est relayée par les théoriciens du Droit qui ne veulent y voir que le produit de forces politiques ou économiques. Tel fut d'abord le sens de la critique matérialiste, selon laquelle, le Droit n'étant qu'une technique de pouvoir au service des puissants, seules les lois révélées par la science s'imposent à l'homme. Brillamment développée par Pasukanis au moment de la Révolution russe, cette thèse a trouvé des formulations nouvelles chez tous ceux, souvent sensibles à l'injustice bien réelle des ordres juridiques positifs, qui dénient toute pertinence à l'idée même de justice dans une analyse « scientifique » du Droit. Mais réduire ainsi le Droit à l'état de pur instrument au service de la force a aussi été la marque distinctive de tous les totalitarismes, qui, lorsqu'ils n'ont pas fait disparaître purement et simplement la forme juridique, l'ont privée de tout effet contraignant pour les détenteurs du pouvoir. Le fait que ces entreprises aient toujours finalement échoué montre la vanité des théories qui prétendent aujourd'hui expliquer le Droit en se passant de l'idée de justice. De telles théories sont généralement le fait d'esprits sincèrement épris de lucidité (même s'ils oublient tout ce que la confortable position universitaire d'où ils les professent doit elle-même à la forme juridique). Mais ceux qui ont eu à réfléchir à ces questions au cœur de la fournaise totalitaire ont fait preuve d'une autre lucidité : « Si la force est absolument souveraine, écrivait ainsi Simone Weil en 1943, la justice est absolument irréelle. Mais elle ne l'est pas. Nous le savons expérimentalement. Elle est réelle au fond du cœur des hommes. La structure du cœur humain est une réalité parmi les réalités de cet univers, au même titre que la trajectoire d'un astre. Il n'est pas au pouvoir d'un homme d'exclure absolument toute espèce de justice des fins qu'il assigne à ses actions. Les nazis eux-mêmes ne l'ont pu. Si c'était possible à des hommes, eux sans doute l'auraient pu [...]. Si la justice est ineffaçable au cœur de l'homme, elle a une réalité en ce monde. C'est la science alors qui a tort. »
L’erreur profonde, et l'irréalisme foncier, des juristes qui croient réaliste d'expulser les considérations de justice de l'analyse du Droit est d'oublier que l'homme est un être bidimensionnel, dont la vie sociale se déploie à la fois sur le terrain de l’être et sur celui du devoir-être. Le Droit n'est ni révélé par Dieu ni découvert par la science, c'est une œuvre pleinement humaine, à laquelle participent ceux qui font profession de l'étudier, et qui ne peuvent l'interpréter sans prendre en considération les valeurs qu'il véhicule. L’œuvre juridique répond au besoin, vital pour toute société, de partager un même devoir-être qui la prémunisse de la guerre civile. Les conceptions de la justice changent évidemment d'une époque à une autre et d'un pays à un autre, mais le besoin d'une représentation commune de la justice dans un pays et à une époque donnés, lui, ne change pas. Le Droit est le lieu de cette représentation, qui peut être démentie par les faits, mais donne un sens commun à l'action des hommes. Ce sont ces vérités très simples que l'expérience des horreurs de la Seconde Guerre mondiale avait remises dans la mémoire des hommes et qu'oublient de nos jours les juristes qui, renouant avec les idéaux positivistes de l'avant-guerre, prétendent, au nom de la Science, que tout « choix de valeur » relève de la morale individuelle et doit demeurer extérieur à la sphère juridique. L'étude du Droit a besoin de savants et d’érudits capables de comprendre les enjeux moraux, économiques et sociaux qui donnent sens à la technique juridique, et non pas d'émules du docteur Diafoirus aspirant au statut de « vrai scientifique ».
D'autres juristes ne nient pas que le Droit ait quelque chose à voir avec la justice, mais c'est pour identifier aussitôt celle-ci à la maximisation des utilités individuelles. C'est le sens de la doctrine Law and Economies, qui consiste à rapporter toute règle à un calcul d'utilité, qui serait à la fois la source et la mesure de sa légitimité. Devenue fort en vogue dans nos universités, cette doctrine vient de trouver le renfort de la Cour de cassation française, qui s'en fait la zélée propagandiste. Les juristes eux-mêmes sont ainsi atteints par la rage du calcul et cherchent à leur tour à réduire la société des hommes à la somme de leurs utilités individuelles. Dans cette perspective, il n'est de droits qu'individuels. Toute règle est commuée en droits subjectifs : droit à la sécurité, à l'information, au respect de la vie privée, à la dignité, à l'enfant, au procès équitable, à la connaissance des origines, etc. On distribue les droits comme on distribuerait des armes, et ensuite que le meilleur gagne ! Ainsi débité en droits individuels, le Droit disparaît comme bien commun. Car le droit a deux faces, l'une subjective et l'autre objective, et ce sont les deux faces d'une même médaille. Pour que chacun puisse jouir de ses droits, il faut que ces droits minuscules s'inscrivent dans un Droit majuscule, c'est-à-dire dans un cadre commun et reconnu par tous. Architecture normative dans laquelle viennent se loger les droits individuels, le Droit procède de l'État, c'est-à-dire de la souveraineté législative d'un Prince ou d'une Nation. C'est l'idée de ce Droit objectif qui aujourd'hui s'estompe, comme du reste l'emploi de la majuscule dont on usait pour le distinguer des droits subjectifs. L'individu n'aurait pas besoin du Droit pour être titulaire de droits, et c'est, tout au contraire, de l'empilement et du choc des droits individuels que résulterait, par addition et soustraction, l'entièreté du Droit.
La common law qui domine aujourd'hui la culture juridique, et d'où nous vient l'analyse économique du Droit, peut rouler d'autant plus facilement sur cette pente qu'elle n'a justement pas de mot pour désigner le Droit objectif. On le traduit par Law, perdant ainsi en chemin non seulement l'idée de direction, de sens commun, que le Droit a tirée de directum, mais aussi la distinction de la loi (legge, Gesetz, ley, etc.) et du Droit (Diritto, Recht, Derecho) qui est commune à tous les pays d'Europe continentale. L’origine de cette distinction se trouve en Droit romain, où la lex désigne le lieu du fondement d'un ordre juridique (ce que traduit bien l'allemand Gesetz : « ce qui est posé ») et ius les règles de fonctionnement de cet ordre. Cette distinction a pris son sens moderne dans la tradition romano-canonique, qui a conçu l'État à l'image du pouvoir pontifical, c'est-à-dire comme État législateur, à la fois source du Droit (i.e. du système des règles) et source des droits (i.e. des prérogatives garanties aux individus). Du ius, l'anglais n'a gardé que la figure du judge et de la Justice, c'est-à-dire celle de la reconnaissance contentieuse des droits individuels (rights). Dans la culture de common law, c'est le juge et non la Couronne (l'État) qui incarne la source ultime de la légitimité, donc la figure totémique de la loi (Law), et il n'y a pas de mot pour désigner l'unité normative d'où les droits individuels tirent leur sens et leur portée. II ne faut évidemment pas exagérer cette différence sémantique, car l'idée de cette unité est bien présente en terre de common law ; mais présente sur un mode mineur, puisque le Droit y procède des droits et non l'inverse. Là, par exemple, où la maîtrise juridique de la mondialisation évoquera d'abord pour un juriste continental la création d'institutions internationales capables de poser des règles communes, elle éveillera plutôt chez un juriste de common law l'idée de la reconnaissance des mêmes droits individuels à tous les habitants de la planète. La common law a prospéré dans les pays protestants qui ont poussé le plus loin l'idée du rapport direct et individuel du fidèle au Texte. Sans qu'il soit besoin de démêler ici l'influence respective de la culture juridique et de la culture religieuse, il faut en retenir cette prédisposition à considérer qu'entre la Loi et l'individu il n'y a rien. La force de cette analyse dans le monde contemporain est de permettre de penser la Loi sans l'État. L'humanité entière peut être regardée par l'analyse économique comme une collection d'individus armés des mêmes droits (droit de vote, droit de propriété, droits de l'homme) dans la compétition qu'ils se livrent sous l'égide d'une Loi unique qui est la loi du marché, c'est-à-dire la loi de la lutte de tous contre tous. Une telle vision des choses permet de faire l'économie de l'État et du Droit, expressions de souverainetés locales n'ayant plus leur place dans le modèle impérial qui fait retour sous le masque de la « mondialisation ».
Mais à faire ainsi de l'individu l'alpha et l'oméga de la pensée juridique, on oublie la seule certitude que peut apporter l'étude du Droit : il n'y a pas d'identité sans limites, et qui ne trouve pas ses limites en lui les trouvera à l'extérieur de lui. Penser l'européanisation ou la mondialisation comme des processus d'effacement des différences et d'uniformisation des croyances, c'est se préparer des lendemains mortifères. Croire universelles ses catégories de pensée et prétendre les imposer au monde est le plus sûr chemin qui conduit au désastre. La vieille Europe en sait quelque chose, qui a parcouru ce chemin tant de fois. La France en particulier, qui, de Waterloo à Diên Biên Phu, a toujours fini par trouver les limites de sa prétention universaliste. L'utopie d'un monde globalisé, qui communierait en pidgin English dans les valeurs du marché et des droits de l'homme, est grosse du même type de déconvenues. L'individualisme radical qui a saisi la pensée juridique conduit à transporter dans une Loi intangible les croyances sur lesquelles le Droit s'est édifié et à faire régner cette Loi sur le monde entier. On verse alors dans un fondamentalisme occidental qui ne peut que nourrir en retour les fondamentalismes issus des autres systèmes de croyance. Prétendant uniformiser le monde, on ruine toute chance de l'unifier. La dissolution du Droit objectif dans une collection de droits individuels garantis par une Loi supposée universelle nous engage ainsi à coup sûr dans le « choc des civilisations », croyance contre croyance, les armes à la main.
Mieux vaudrait revenir à ce qui a fait la grande singularité du Droit : non pas les croyances sur lesquelles l'Occident a prospéré, mais les ressources d'interprétation qu'il recèle. Comme n'importe quel autre système normatif, le Droit remplit une fonction d'interdit : il est une Parole qui s'impose à tous et s'interpose entre chaque homme et sa représentation du monde. Partout ailleurs, cette fonction anthropologique a été le lot des religions, qui, en conférant un sens commun à la vie humaine, ont jugulé le risque de voir chacun sombrer dans le délire individuel auquel nous expose l'accès au langage. La particularité du Droit, depuis son apparition dans l'Antiquité gréco-romaine, est de s'être progressivement détaché de cette origine religieuse et d'avoir opéré ce que Louis Gernet a pu appeler une « laïcisation de la parole ». Le Droit est ainsi devenu une technique de l'Interdit. C'est une technique parce que son sens n'est pas enfermé dans la Lettre d'un Texte sacré et immuable, mais procède, comme celui de n'importe quel autre objet technique, de fins qui lui sont données de l'extérieur par l'Homme, de fins humaines et non pas divines. Mais c'est une technique de l'Interdit, qui interpose, dans les rapports de chacun à autrui et au monde, un sens commun qui le dépasse et l'oblige, et fait de lui un simple maillon de la chaîne humaine. Le Droit peut donc servir des fins diverses et changeantes, aussi bien dans l'histoire des systèmes politiques que dans celle des sciences et des techniques, mais il les sert en subordonnant le pouvoir et la technique à une raison humaine. Il est donc aussi faux de le réduire, comme on tend à le faire aujourd'hui, à une « pure technique » vide de signification que de le rapporter, comme on le faisait hier, aux règles réputées immuables d'un supposé Droit naturel. Car, dans chaque cas, on manque l'essentiel, qui est la capacité du Droit de mettre à la raison les formes les plus diverses d'exercice du pouvoir politique ou de la puissance technique.
C'est cette capacité qui mérite aujourd'hui d'être rappelée et défendue. Il serait fou de vouloir faire du Droit l'instrument de la propagation de nos croyances. Mais il est raisonnable d'espérer que les ressources de l'interprétation propres à la technique juridique nous évitent les peines de l'autisme en nous forçant à voir la Justice avec le regard des autres. Ne reposant pas sur un credo à jamais enfermé dans la lettre d'un Texte ou dans les certitudes d'une Science fétichisée, les ressources dogmatiques du Droit ne peuvent fonder que des équilibres fragiles, toujours menacés par la tentation du fondamentalisme. Le nihilisme juridique et le fanatisme religieux ne sont que les deux faces de cette même tentation et se nourrissent aujourd'hui l'un l'autre, laissant insatisfaite la créance de sens des générations montantes et ouvrant ainsi les vannes de la violence. Le Droit n'est pas l'expression d'une Vérité révélée par Dieu ou découverte par la Science ; il n'est pas davantage un simple outil qui pourrait se juger à l'aune de l'efficacité (efficace pour qui ?). Comme les instruments de mesure de la Melencholia de Durer, il sert à approcher, sans jamais pouvoir l'atteindre, une représentation juste du monde.
[1] Alain Supiot, Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Éditions du Seuil, 2005.