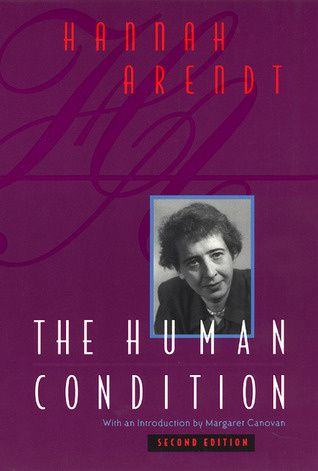Essai de présentation de Condition de l'homme moderne
La publication des Origines du totalitarisme laisse Arendt avec un constat et un questionnement. Le constat est celui des dangers et des problèmes non résolus de la vie moderne auxquels le totalitarisme, selon ses propres termes, semblait apporter une terrifiante solution.
L’interrogation concerne la pensée philosophique qui va des Lumières à Marx. Comment une telle école de pensée a-t-elle pu servir de base à une idéologie totalitaire fondée sur le déni de la liberté et de la dignité? Arendt soupçonne que la pensée de Karl Marx ne peut être si facilement séparée de sa déformation stalinienne. Elle démarre dès 1951 un travail de recherche sur les « éléments de totalitarisme dans le marxisme ».
Elle en vient rapidement à la conclusion que Marx n’est pas un ami de la liberté humaine, et que ses idées et catégories fondamentales font l’impasse sur les expériences politiques de base, comme le débat entre des citoyens divers et égaux. Mais, pour elle, le vrai choc est ailleurs. C’est au début même de la pensée occidentale, découvre-t-elle chez Platon puis Aristote, qu’a été tracé un cadre conceptuel hostile à la pluralité humaine. Les conséquences en été considérables sur notre façon de penser l’action politique, la liberté, le jugement, et, par-dessus tout, la relation entre la pensée et l’action. Arendt abandonne alors son projet de livre sur Marx pour tenter une réorientation fondamentale de la théorie politique.
Cette réorientation comporte deux moments. En premier lieu, une lecture critique ou « déconstructrice » des penseurs « canoniques », de Platon à Marx, vise à révéler les sources de l’hostilité de la tradition philosophique occidentale envers la pluralité, l’opinion et la politique du débat et de la délibération entre égaux. En second lieu, une tentative de description de la vie active tente de faire la distinction entre la capacité humaine pour l’action et la parole politiques et les activités liées à la nécessité naturelle (le travail) ou au besoin de créer des choses durables, un artifice humain, un monde (l’œuvre). Arendt pense que la tradition occidentale a progressivement confondu les composantes distinctes de la vie active et créé un ensemble de concepts qui déforment fondamentalement l’expérience politique et la compréhension que nous en avons. Chaque fois que ces concepts ont été appliqués systématiquement aux affaires humaines, ils nous ont plongés dans un monde horrible.
Condition de l’homme moderne (1958) et les essais rassemblés dans La Crise de la culture (1961) sont les résultats de ce travail de réorientation de la théorie politique.
Présentation globale de Condition de l’homme moderne
La structure du livre est, au premier niveau, relativement simple. Six chapitres suivent un prologue démarrant avec le lancement de Spoutnik 1, en 1957, et se terminant par l’exposition du thème central du livre : « rien de plus que de penser ce que nous faisons ».
Les deux premiers chapitres « plantent le décor » dans lequel s’inscrivent les trois activités humaines, travail œuvre et action longuement étudiées dans les trois chapitres qui suivent. Arendt termine son livre par une analyse de l’impact de l’âge moderne sur la vie active.
Quarante-cinq intertitres rythment et structurent ces six chapitres, tout en traduisant la complexité et la subtilité de la pensée « corallienne » d’Arendt.
Certains passages du prologue apparaissent aujourd’hui comme prophétiques, tels celui concernant l’évolution de nos sociétés vers des sociétés de travailleurs sans travail ou, moins connus, ceux consacré aux grandes victoires de la Science et à leurs implications philosophiques et politiques. Retenons en, pour l’instant, que ce que nous propose Arendt avec ce livre : rien de plus que de penser ce que nous faisons[1].
Pour nous aider à penser ce que nous faisons Arendt nous propose d’utiliser le terme de vie active (vita activa) pour regrouper et distinguer les trois activités humaines fondamentales correspondant chacune aux conditions de base dans lesquelles la vie sur terre est donnée à l’homme.
- Le travail est l’activité qui correspond au processus biologique du corps humain, à la vie elle-même.
- L’œuvre est l’activité qui correspond à la non-naturalité de l’existence humaine, à l’appartenance au monde. L’œuvre fournit un monde artificiel d’objets, nettement différent de tout milieu naturel, dans lequel se loge chacune des vies individuelles, destiné à leur survivre et à les transcender.
- L’action, seule activité qui mette directement en rapport les hommes, sans l’intermédiaire des objets ni de la matière, correspond à la condition humaine de la pluralité, au fait que ce sont des hommes et non pas l’Homme, qui vivent sur terre et habitent le monde : tous humains, donc semblables, mais tous uniques car différents de tout homme ayant vécu, vivant ou à naître.
Ces distinctions constituent trois angles de vue utilisés par Arendt pour analyser l’évolution de l’activité humaine :
- Celui du travail et de la nécessité;
- Celui de l’œuvre et du monde;
- Celui de l’action et de la pluralité.
Depuis 1958 la confusion à laquelle s’attaque Arendt, entre domaines privé, public, social et même intime, s’est encore accrue. Comme chaque fois qu’elle se retrouve face à des concepts qui sont devenus vides de sens, Arendt remonte aux sources de la pensée occidentale pour y retrouver leur origine et pour les repenser, donc à la Grèce. Limitons nous pour l’instant à son analyse des domaines public et privé.
Le mot public désigne, nous dit-elle, deux phénomènes, deux domaines liés l’un à l’autre mais différents. En premier lieu, le mot public désigne l’espace public, l’espace d’apparence, où chacun peut montrer qui il est et voir qui sont les autres. Ce qui est vu et entendu par autrui comme par nous-mêmes, constitue la réalité.
En second lieu, le mot public désigne le monde humain. Artificiel, lié aux productions et aux objets humains, distinct de la Terre et de la nature, le monde nous accueille à notre naissance et nous le nous laissons derrière nous en mourant. Il transcende notre vie personnelle aussi bien dans le passé que dans l’avenir : il était là avant nous, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui nous ont précédés et avec ceux qui viendront après nous.
Avant les temps modernes qui commencèrent par l'expropriation des pauvres, toutes les civilisations reposaient sur le caractère sacré de la propriété privée. Le privé désignait alors la parcelle possédée en un certain lieu du monde qui permettait d’appartenir à la cité politique. Cette parcelle du monde s'identifiait si complètement avec la famille qui la possédait que l'expulsion d'un citoyen pouvait entraîner non seulement la confiscation de ses biens, mais même la destruction de sa maison. Sans ce privé, source du nécessaire, du vital, le commun, le public ne servait à rien.
D'origine toute différente et historiquement plus récente est le privé au sens de la fortune privée d'où l'homme tire ses moyens de vivre. Être propriétaire, dans ce cas, signifie que l'on domine les nécessités de son existence, qu’on est libre de transcender sa vie individuelle et d'entrer dans le monde commun.
Les États prémodernes protégeaient les bornes séparant la propriété privée de toutes les autres parties du monde et surtout du monde commun lui-même. Les États modernes, au contraire, dans la mesure où ils voient dans la propriété privée un frein à l’accumulation des richesses, protègent les activités privées aux dépens de la propriété concrète. Ce n’est pas sans conséquence, nous dit Arendt, sur le domaine public qui plus que de l'énergie plus ou moins entreprenante des gens d'affaires, a besoin des barrières qui entourent les maisons et les jardins des citoyens, une vie passée entièrement en public, en présence d'autrui, devenant dangereusement superficielle.
L’origine de la distinction posée par Arendt entre le travail et l’œuvre ne se trouve dans aucune théorie mais dans les langues européennes, anciennes et modernes, qui possèdent deux mots étymologiquement séparés pour désigner ce que nous considérons aujourd'hui comme une seule et même activité. Le langage et les expériences humaines fondamentales qu'il recouvre nous enseignent que les choses du monde au sein duquel se loge la vie active sont de natures très diverses et qu'elles sont produites par des activités très différentes.
Les produits de l’œuvre garantissent la permanence, la durabilité, sans lesquelles il n’y a pas de monde possible. Le travail produit, quant à lui, les biens de consommation par lesquels la vie s'assure ses moyens de subsistance. Il lutte, aussi, de façon incessante contre les processus de croissance et de déclin par lesquels la nature menace la durabilité du monde et son aptitude à servir aux hommes.
Arendt se pose une question centrale. Pourquoi le travail, activité considérée comme l’activité la plus basse par les anciens[2], devient-il la mieux considérée des activités humaines à l’époque moderne ? C’est dans la confrontation, à partir du XVIIe siècle, des théoriciens politiques (John Locke, Adam Smith puis Marx) avec l'accroissement inouï de richesse, de propriété et d'acquisition qu’ils observent, qu’elle trouve une réponse. Essayant d’expliquer cette croissance, ils identifient le phénomène du processus[3] qui devient le concept-clef de l'époque et de ses sciences, historiques et naturelles. Et, de toutes les activités humaines, seul le travail relève d’un processus sans fin qui avance automatiquement en accord avec le processus vital, hors de portée des décisions ou des projets humainement explicites. Marx découvre la «force de travail» comme mode spécifiquement humain de la force vitale aussi capable que la nature de créer une plus-value, un surproduit. S'intéressant presque exclusivement à ce processus, il ignore complètement la question d'une existence séparée d'objets du-monde dont la durabilité résiste et survit aux processus dévorants de la vie. Il oublie l’œuvre.
La division du travail, facilitée par les instruments et outils fabriqués par l’œuvre, garantit le caractère inépuisable de la force de travail collective qui correspond à l'immortalité de l'espèce. Mais la capacité de consommation, elle, reste liée à l’individu. Le problème est donc d'adapter la consommation individuelle à un processus d’accumulation illimitée de richesse. La solution est assez simple. Elle consiste à traiter tous les objets d'usage comme des biens de consommation. La révolution industrielle remplace l'artisanat par le travail. Les objets du monde moderne deviennent des produits du travail dont le sort naturel est d'être consommés, au lieu d'être des produits de l'œuvre destinés à servir.
Nous vivons dans une société de consommateurs et donc de travailleurs, travail et consommation n’étant que les deux stades d'un même processus imposé à l'homme par la nécessité de la vie. Toutes les activités sérieuses, quels qu'en soient les résultats, reçoivent le nom de travail et toute activité qui n'est nécessaire ni à la vie de l'individu ni au processus vital de la société est rangée parmi les amusements, les passe-temps.
Que l'émancipation du travail à l'époque moderne non seulement échoue à instaurer une ère de liberté universelle mais aboutisse au contraire à courber toute l'humanité pour la première fois sous le joug de la nécessité, c'est un danger que Marx avait bien aperçu lorsqu'il soulignait que le but de la révolution ne pouvait pas être l'émancipation déjà accomplie des classes laborieuses mais devait consister à émanciper l'homme du travail. Les perspectives ouvertes ces dernières années par le progrès de l'automatisation, font que l'on peut se demander si l'utopie de Marx ne sera pas la réalité de demain, et si un jour l'effort de consommation ne sera pas tout ce qui restera des labeurs et des peines inhérents au cycle biologique.
Cependant, l'espoir qui inspira Marx et l'élite des divers mouvements ouvriers repose sur l'illusion que la force de travail, si elle n'est pas épuisée dans les corvées de la vie, nourrira automatiquement des activités plus hautes. Cent ans après Marx, Arendt voyait l'erreur de ce raisonnement. Les loisirs de l’animal laborans, l’animal travaillant, ne sont consacrés qu'à la consommation, et plus on lui laisse de temps, plus ses appétits deviennent exigeants, insatiables.
Le danger d’une société de consommation, éblouie par l'abondance de sa fécondité, prise dans le fonctionnement béat d'un processus sans fin, est de n’être plus capable de reconnaître la futilité d'une vie qui ne se fixe ni ne se réalise en un monde qui dure après que son labeur est passé.
L'œuvre de nos mains fabrique l'infinie variété des objets dont la somme constitue le monde, l'artifice humain. L'usage que nous en faisons les use, le processus vital aussi. La chaise redevient bois, le bois pourrit et retourne au sol d'où l'arbre était sorti avant d'être coupé pour devenir un matériau à œuvrer, avec lequel bâtir. Mais si telle est la fin inévitable de chaque objet au monde, ce n'est pas le sort du monde lui-même où chaque objet peut constamment être remplacé à mesure que changent les générations qui viennent l’habiter.
L’œuvre est la seule activité entièrement déterminée par les catégories de la fin et des moyens. La fin arrive dès qu'un objet entièrement nouveau, assez durable a été ajouté au monde. Contrairement au travail, l’œuvre ne génère aucun besoin de reproduction ou de multiplication.
L’œuvre, contrairement à l’action, n'est pas irréversible. Tout ce qui est créé, produit par l'homme peut être détruit par l'homme, et aucun objet d'usage n'est si absolument nécessaire au processus vital que son auteur ne puisse lui survivre ou en supporter la destruction. L’homme fabricateur est bien seigneur et maître, non seulement parce qu'il est ou s'est fait maître de la nature, mais surtout parce qu'il est maître de soi et de ses actes. Il en va différemment avec la Science moderne où, de plus en plus, l’homme ne produit pas à partir de la nature mais agit avec et sur elle.
L'homme, en tant qu’homme fabricateur, instrumentalise. Tout se dégrade en moyens, tout perd sa valeur intrinsèque et indépendante. Les Grecs redoutaient cette dévaluation du monde et de la nature, et l'anthropocentrisme qui lui est inhérent. Platon vit immédiatement que si l'on fait de l'homme la mesure de tous les objets d'usage, c'est avec l'homme usager et instrumentalisant que le monde est mis en rapport, et non pas avec l'homme parlant et agissant ni avec l'homme pensant. Si on laisse les normes de l'homme fabricateur gouverner le monde fini comme elles gouvernent la création de ce monde, il se servira un jour de tout et considérera tout ce qui existe comme un simple moyen à son usage. Il classera toutes choses parmi les objets d'usage et, pour reprendre l'exemple de Platon, on ne comprendra plus le vent tel qu'il est comme force naturelle, on le considérera exclusivement par rapport aux besoins humains[4] ce qui, évidemment, signifie que le vent en tant que chose objectivement donnée aura été éliminé de l'expérience humaine.
Les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du-monde. Leur durabilité peut atteindre à la permanence à travers les siècles. Tout se passe comme si la stabilité du-monde se faisait transparente dans la permanence de l'art, de sorte qu'un sentiment d'immortalité, non pas celle de l'âme ni de la vie, mais d’un monde immortel fait par de mains mortelles devient tangible et présent pour resplendir et qu'on le voie, pour chanter et qu'on l'entende, pour parler à qui voudra lire.
La vie au sens non biologique, le laps de temps dont chaque humain dispose entre la naissance et la mort, se manifeste dans l'action et dans la parole. Mais Les hommes de parole et d'action ont besoin de l'homme fabricateur, l’homo faber, en sa capacité la plus élevée. Ils ont besoin de l'artiste, du poète et de l'historiographe, du bâtisseur de monuments ou de l'écrivain, car sans eux le seul produit de leur activité, l'histoire qu'ils jouent et qu'ils racontent, ne survivrait pas un instant.
L’action est l’activité qui fait de notre vie une vie véritablement humaine. La pluralité humaine, condition fondamentale de l'action et de la parole, présente le double caractère de l'égalité et de la distinction. Égaux, les hommes peuvent se comprendre les uns les autres, comprendre ceux qui les ont précédés, préparer l'avenir et prévoir les besoins de ceux qui viendront après eux. Distincts, chaque être humain se distinguant de tout autre être présent, passé ou futur, ils ont besoin de la parole et de l'action pour se faire comprendre.
Le domaine des affaires humaines est constitué du réseau des relations humaines, qui existe partout où des hommes vivent ensemble. Une action nouvelle s’insère toujours dans un réseau déjà existant. C'est à cause de ce réseau, avec ses innombrables conflits de volontés et d'intentions, qu’elle n'atteint presque jamais son but. Mais c'est aussi à cause de ce réseau que l’action produit, intentionnellement ou non, des histoires, aussi naturellement que la fabrication produit des objets.
Dans sa remontée vers les sources de la pensée occidentale, Arendt découvre que l’exaspération face aux caractéristiques de l'action (résultats imprévisibles, processus irréversible, auteurs anonymes) est presque aussi ancienne que l'Histoire écrite. Lui trouver un substitut dans l'espoir d'épargner au domaine des affaires humaines le hasard et l'irresponsabilité morale qui sont inhérents à une pluralité d'agents a préoccupé tout autant les hommes d’action que les hommes de pensée. Avec une monotonie remarquable des solutions proposées tout au long de l'Histoire. Le problème, selon Platon, est de s'assurer que l'homme qui entreprend reste entièrement maître de ce qu'il a entrepris sans avoir besoin de l'aide d'autrui pour le mener à bien. Dans le domaine de l'action, on ne saurait atteindre à cette maîtrise isolée que si les autres n'ont plus à participer à l'entreprise de leur plein gré, pour leurs raisons et leurs fins personnelles, mais qu'on les utilise à exécuter des ordres, et si, d'autre part, le novateur qui a pris l'initiative ne se laisse pas entraîner dans l'action elle-même. L’agir est remplacé par le faire, l’action par l’œuvre.
Tout le vocabulaire de la théorie et de la réflexion politiques témoigne de la persistance et du succès de la métamorphose de l'action en un mode de la fabrication. Il en devient presque impossible de traiter ces questions sans employer la catégorie de la fin et des moyens. On peut trouver plus persuasive encore l'unanimité avec laquelle certains proverbes dans toutes les langues modernes nous assurent que «qui veut la fin veut les moyens» et que «l'on ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs». [5]
Notre génération, écrit Arendt, est peut-être la première à bien voir les conséquences meurtrières d'une ligne de pensée qui force à admettre que tous les moyens, pourvu qu'ils soient efficaces, sont bons et justifiés à poursuivre ce qu'on aura défini comme fin. Tant que nous croirons avoir affaire à des fins et à des moyens dans le domaine politique, nous ne pourrons empêcher personne d'utiliser n'importe quels moyens pour poursuivre des fins reconnues.
Souhaitant redonner à l’action politique sa véritable dimension (ce qu’elle développera dans De la révolution), Arendt recherche des remèdes à ses deux maux : l’irréversibilité ou l’infinitude et l’imprévisibilité. La rédemption possible de la situation d’irréversibilité c'est la faculté de pardonner. Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Ces deux facultés vont de pair.
La première, celle du pardon sert à supprimer les actes du passé, dont les fautes sont suspendues comme l'épée de Damoclès au-dessus de chaque génération nouvelle. La seconde, qui consiste à se lier par des promesses, sert à disposer, dans cet océan d'incertitude qu'est, par définition, l'avenir, des îlots de sécurité sans lesquels aucune continuité et durée, ne seraient possible dans les relations des hommes entre eux. Les deux facultés dépendent de la pluralité, de la présence et de l'action d'autrui, car nul ne peut se pardonner à soi-même, nul ne se sent lié par une promesse qu'il n'a faite qu'à soi. Parce que les remèdes à la force énorme, aux prodigieux ressorts de l'action ne peuvent opérer que dans la condition de pluralité, il est très dangereux d'employer cette faculté ailleurs que dans le domaine des affaires humaines.
Ces remèdes ne sont d’aucune utilité dans le domaine où s’est concentrée, avec l’époque moderne, la faculté d'agir, d'entreprendre des processus nouveaux et spontanés qui n'existeraient pas sans l'homme, celui de l’attitude envers la nature[6]. Alors que les hommes ont toujours été capables de détruire n'importe quels produits de la main humaine, ils n'ont jamais pu et ils ne pourront jamais anéantir ni même contrôler sûrement le moindre des processus que l'action aura déclenchés. Et cette incapacité à défaire ce qui a été fait s'accompagne d'une incapacité presque aussi totale à prédire les conséquences de l'acte ou même à s'assurer des motifs de cet acte.
C’est dans ce dernier chapitre que Hannah Arendt démontre toute la pertinence des distinctions qu’elle a opérées dans et autour de la vie active. À partir des trois évènements qui dominent le seuil de l’époque moderne (la découverte de l’Amérique suivie de l’exploration du globe, la Réforme, l’invention du Télescope) elle décrit et analyse la réaction en chaîne qui a conduit, à ce qu’elle appelle, la double aliénation de l’homme moderne, évoquée dès le prologue : la fuite de la Terre pour l’Univers, du Monde pour le Moi.[7] Déroulons en les éléments clés.
Le premier, avec la réforme, est la perte du lien avec le Monde. L’expropriation du paysannat, conséquence imprévue de l'expropriation de l'Église, a précipité l'Occident dans une Histoire où l'on a vu la propriété détruite dans le processus de son appropriation, les objets dévorés dans le processus de leur production, la stabilité du monde sapée dans un processus perpétuel de changement. L'éclipse du monde public commun, si décisive pour la solitude de l'homme de masse, si dangereuse par l'aliénation des mouvements idéologiques de masse dont elle est la cause, a commencé très concrètement par la perte de cette parcelle du monde que l'homme possédait en privé.
Le deuxième, avec la découverte de l’Amérique puis l’invention du Télescope, est la perte du lien avec la Terre. En explorant la Terre, en la mesurant et en l’arpentant l’homme s’est dégagé de tout attachement, de tout intérêt pour ce qui est proche de lui, et s’est éloigné de son voisinage. Éloignement accentué avec l’invention par Galilée[8]du télescope et l’avènement d’une science nouvelle considérant la nature terrestre du point de vue de l’univers. Sans nous tenir réellement en ce point dont rêvait Archimède[9], liés encore à la Terre par la condition humaine, nous avons trouvé le moyen d'agir sur la Terre et dans la nature terrestre comme si nous en disposions. Et au risque même de mettre en danger le processus naturel de la vie nous exposons la Terre à des forces cosmiques, universelles, étrangères à l'économie de la nature.
Le troisième, conséquence des inventions de l'époque moderne comme le télescope, est l'inversion de la hiérarchie entre la contemplation et la vie active. La certitude d'une connaissance n’est devenue accessible qu'à une double condition. La première, qu’elle ne concerne que ce que l’homme a fait lui-même, avec pour idéal la connaissance mathématique où l'on n'a affaire qu'à des entités autonomes de l'esprit. La seconde est que la connaissance soit d'une nature telle qu'elle ne puisse se vérifier autrement que par l’expérimentation. Depuis lors, vérité scientifique et vérité philosophique se sont quittées. La pensée, autrefois servante de la contemplation, devint servante de l’expérimentation et la philosophie devint superflue pour les hommes de sciences.
Le quatrième est la victoire du processus. Parmi les activités de la vie active la première à s'emparer de la place jadis occupée par la contemplation fut celle du faire, de la fabrication, de l’œuvre sous le double effet de l’importance des instruments et de l'expérimentation dans la Science moderne. Science dans laquelle règne la conviction que l'on ne peut connaître que ce que l'on a fait entraînant le passage des anciennes questions, « quoi » et « pourquoi », à la nouvelle question, « comment ». Les objets de connaissance ne peuvent plus être des choses ni des mouvements éternels, mais des processus. L'homme a commencé à se considérer comme une partie intégrante des deux processus surhumains, universels, de la Nature et de l'Histoire, condamnés l'un et l'autre à progresser indéfiniment sans jamais atteindre de fin[10] inhérente, sans jamais approcher d'idée préétablie.
Le cinquième est la victoire du principe du bonheur sur le principe de l’utilité. L'homme cessa de se définir comme fabricant d'objets, constructeur de l'artifice humain, du monde, pour se considérer principalement comme fabricant d'outils, produisant aussi incidemment des objets. Le principe d’utilité, propre à l’homme fabricateur ne concerne plus que le processus de production. Ce qui contribue à stimuler la productivité et à diminuer le labeur, l'effort, est utile. Le repère ultime n'est ni l'usage ni l'utile, c'est «le bonheur», c'est l'évaluation de la peine et du plaisir éprouvés dans la production et dans la consommation. Le « bonheur » selon Bentham[11], somme des plaisirs moins les peines, devient un sens interne sans aucun lien avec les objets-de-ce-monde.
Le sixième, est la persistance dans la société moderne de la vie, et non du monde, comme souverain bien. Si la vie s'est imposée à l'époque moderne comme ultime point de repère c'est que le renversement moderne entre vie contemplative et vie active s'est opéré dans le contexte d'une société chrétienne dont la croyance fondamentale au caractère sacré de la vie a survécu, absolument intacte, après la laïcisation et le déclin général de la foi chrétienne. Le renversement extrêmement important provoqué dans le monde antique par le christianisme entre l’homme et le monde, l’immortalité de la vie individuelle remplaçant celle du monde loin d’être remis en question, a été conservé.
Le septième, et dernier élément, est la victoire du travail, de l’animal laborans. La primauté de la vie avait acquis pour les penseurs modernes un statut de vérité axiomatique, et elle le conserve même dans notre monde actuel qui a déjà commencé à dépasser toute l'époque moderne et à substituer à la société du travail une société d'employés. Il ne s'ensuit nullement que nous vivions encore dans un monde chrétien. Car, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas l'immortalité, c'est que la vie soit le souverain bien. Mais tout ce qu'il reste désormais de virtuellement immortel, d'aussi immortel que la cité dans l'antiquité ou la vie individuelle au moyen âge, c’est la vie comme processus vital, potentiellement sempiternel, de l'espèce. Le mot travail est trop noble, trop ambitieux, pour désigner ce que nous faisons ou croyons faire dans le monde où nous sommes. Le dernier stade de la société de travail, la société d'employés, exige de ses membres un pur fonctionnement automatique, comme si la vie individuelle était réellement submergée par le processus global de la vie de l'espèce, comme si la seule décision encore requise de l'individu était d'acquiescer à un type de comportement, hébété, « tranquillisé » et fonctionnel.
Si l'on compare le monde moderne avec celui du passé, la perte d'expérience humaine que comporte cette évolution est extrêmement frappante. Ce n'est pas seulement, ni même principalement, la contemplation qui est devenue une expérience totalement dénuée de sens. La pensée elle-même, en devenant « calcul des conséquences », est devenue une fonction du cerveau, et logiquement on s'aperçoit que les machines électroniques remplissent cette fonction beaucoup mieux que nous. L'action a été vite comprise, elle l'est encore, presque exclusivement en termes de faire et de fabrication, à cela près que la fabrication, à cause de son appartenance-au-monde et de son essentielle indifférence à l'égard de la vie, passa bientôt pour une autre forme du travail, pour une fonction plus compliquée mais non pas plus mystérieuse du processus vital.
[1] À ces préoccupations, à ces inquiétudes, le présent ouvrage ne se propose pas de répondre. Des réponses on en donne tous les jours, elles relèvent de la politique pratique, soumise à l'accord du grand nombre; elles ne se trouvent jamais dans des considérations théoriques ou dans l'opinion d'une personne : il ne s'agit pas de problèmes à solution unique. Ce que je propose dans les pages qui suivent, c'est de reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Il s'agit là évidemment de réflexion, et l'irréflexion (témérité insouciante, confusion sans espoir ou répétition complaisante de « vérités » devenues banales et vides) me paraît une des principales caractéristiques de notre temps. Ce que je propose est donc très simple : rien de plus que de penser ce que nous faisons.
[2] Celle des esclaves et des femmes
[3] Arendt revient longuement sur ce point dans les deux derniers chapitres.
[4] par exemple, comme une énergie renouvelable
[5] Ce contre quoi Albert Camus s’élève dans L’homme révolté (1951) : « Une action révolutionnaire qui se voudrait cohérente avec ses origines devrait se résumer dans un consentement actif au relatif. Elle serait fidélité à la condition humaine. Intransigeante sur ses moyens, elle accepterait l'approximation quant à ses fins et, pour que l'approximation se définisse de mieux en mieux, laisserait libre cours à la parole. Elle maintiendrait ainsi cet être commun qui justifie son insurrection. Elle garderait, en particulier, au droit la possibilité permanente de s'exprimer ».
[6] À quel point nous avons commencé à agir sur la nature, au sens littéral du mot, on peut l'entrevoir d'après une remarque faite en passant par un savant qui déclarait fort sérieusement : « La recherche fondamentale, c'est quand je fais ce que je ne sais pas que je fais. » Werner von Braun dans le New York Times du 16 décembre 1957.
[7] Je vous renvoie au dernier cours de la première saison dans lequel j’ai donné un aperçu et fourni un guide de lecture de cette analyse.
[8] Mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien, né à Pise le 15 février 1564 et mort à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642.
[9] né à Syracuse vers 287 av. J.-C. et mort à Syracuse en 212 av. J.-C., grand scientifique grec de l'Antiquité, physicien, mathématicien et ingénieur.
[10] télos : fin, but
[11] Jeremy Bentham né le 15 février 1748 à Londres et mort dans cette même ville le 6 juin 1832 est un philosophe, jurisconsulte et réformateur britannique. Il est surtout reconnu comme étant le père de l'utilitarisme avec John Stuart Mill.